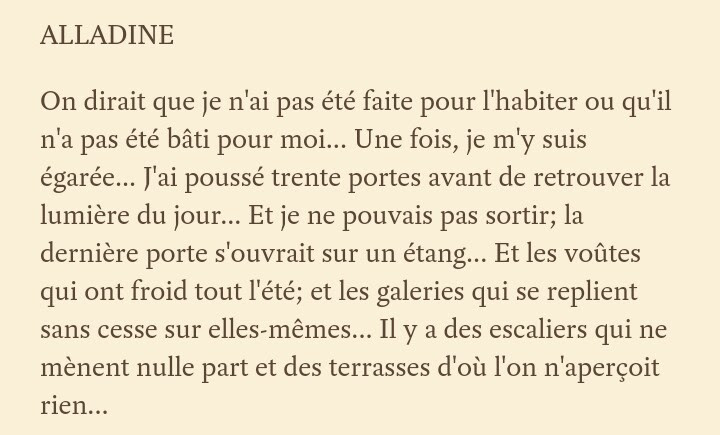mercredi 2 juillet 2025
Leitmotive de PELLÉAS & Fortune du FREISCHÜTZ – les notules vidéo
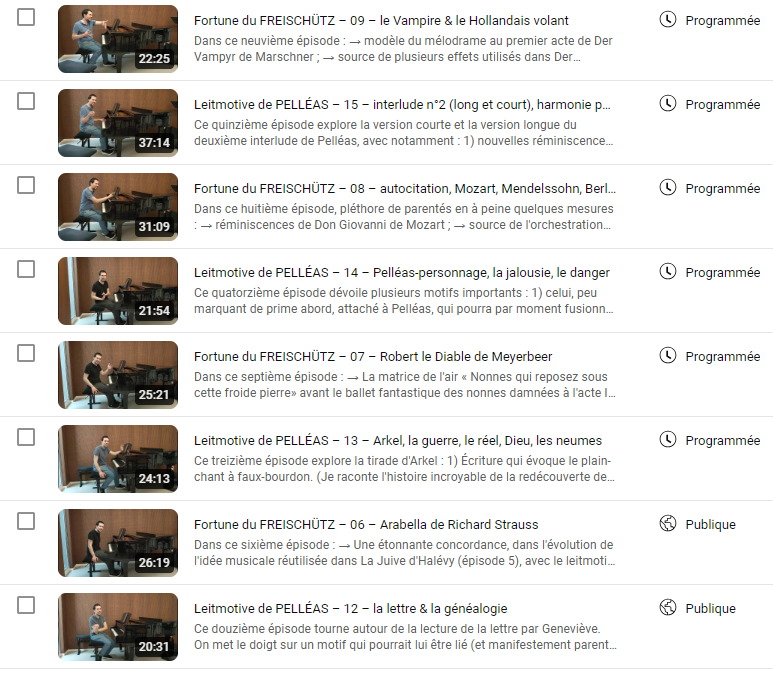
Aperçu des prochaines publications en format vidéo.
A. Le concept
À présent que la série Leitmotive de PELLÉAS est lancée en vitesse de croisière (tout l'acte I est capté, ainsi que la première scène de l'acte II, échelonnement de publication tous les samedis jusqu'à fin juillet) et que la série Fortune du FREISCHÜTZ est achevée (publication automatique tous les mercredis, jusqu'en septembre), je ne reviendrai probablement pas ici sur chaque nouvelle parution. Mais je voudrais en dire un mot supplémentaire.
Sachez donc que cette série qui explore les leitmotive dans Pelléas – un phénomène réel, quoi qu'en die Pierrot le Fou –, et de même, celle dédiée à l'influence de la Gorge du Loup, dans le Freischütz de Weber, sur toute la musique du XIXe siècle, sont issues de désirs de notules contrariés par la lourdeur logistique de l'entreprise et la charge considérable en temps à allouer.
Je me figure, dans l'imaginaire épique qui est le mien, qu'un certain nombre de lecteurs fidèles se sentent apassablement trahis par ce passage de l'écrit, plus structurant (et plus rapide à ingérer !), au profit de la superficialité de la vidéo, accréditant toutes les craintes de tiktokification de l'humanité.
Pourtant ce n'est pas un renoncement à la notule écrite – j'ai conscience qu'elle est plus commode, et je suppose que les lecteurs réguliers de CSS sont attachés à son format, à son ton –, mais bien la possibilité de faire vivre celles qui, trop ambitieuses, ne pourraient jamais voir le jour.
En réalité, outre que ce format m'était réclamé depuis un certain temps par quelques lecteurs ou amis, l'impact se révèle nul sur la production de notules écrites : ce n'est pas le même quota temps qui est utilisé. Et, surtout, ce travail que je souhaitais réaliser depuis longtemps peut voir le jour à court terme, tout simplement impossible à réaliser en notule, puisque je joue dans l'ordre l'intégralité de l'opéra, en l'entrecoupant de commentaires et de références à d'autres œuvres. La quantité de texte à écrire et de sons à incruster (passage complet, sous-passage, détail, parentés…) n'est tout simplement pas envisageable, sauf à en faire un temps plein sur plusieurs années.
S'il en existe un jour une déclinaison écrite, ce sera donc plutôt la transcription du texte des vidéos sans les extraits afférents, en guise de témoignage.
En revanche, je prévois bien, à la fin de l'exercice (un mois et demi pour publier les 11 épisodes de la scène 1, je vous laisse mesurer le temps qui nous sépare de l'achèvement du cycle), de produire quelques notules autour des faits « motiviques » les plus marquants de Pelléas : quelques-unes des mutations ou des superpositions les plus parlantes ; ou bien certains thèmes que je n'aurais pas rencontrés dans les livres mais que j'aurais identifiés, à travers plusieurs moments de l'œuvre – le motif de la clarté me semble un client intéressant pour cet exercice, mais il faut encore que je confronte mon intuition à l'entièreté de la partition d'abord, et du corpus critique ensuite. Car il est possible que je n'aie pas encore lu les pages où il est identifié, ou bien qu'il soit attribué à une autre idée – ce qui m'amènera à coup sûr à débattre des différentes hypothèses.
Bref, il faudra vraisemblablement attendre avant que tout ceci ne soit publié sous forme écrite, et de façon très partielle. C'est pourquoi j'invite les pelléassiens curieux, qui sont nombreux parmi les lecteurs de ces pages, à aller jeter un œil à la série.
Certes, c'est, pour des raisons évidentes de temps – j'abomine le montage, aussi, très long et abrutissant –, produit de façon totalement brute : capté sans interruption, cadrage fixe, vraiment juste une communication filmée. Rien à voir avec les productions merveilleuses qui sont devenues la norme sur YouTube, où des professionnels de la musique jouent parfaitement filmés sous huit angles, avec des incrustations d'images rigolotes, des écrans dans l'écran et un montage extrêmement rythmé. Par ailleurs, dans les premiers épisodes, en l'absence de matériel adéquat, la voix paraît captée de façon un peu lointaine, il faut clairement pousser le potentiomètre par rapport aux autres vidéos de la plate-forme. (Mais je passe quelques heures à enregistrer ça, vous pouvez bien, si le contenu vous intéresse, augmenter un peu le volume, ce n'est pas un drame. Simplement ça ne s'adressera qu'à un petit contingent, aucun spectateur externe ne sera attiré par la forme, clairement. Même si, croyez-le ou non, des non mélomanes que je ne connais pas regardent et semble-t-il apprécient ! Leur intrépidité m'impressionne.)
Surtout, je pense que ce format, même sous sa forme rudimentaire actuelle, conserve plusieurs atouts.
1) Il n'existait pas, à ma connaissance, de proposition vidéo un peu précise et longue sur la structure musicale de Pelléas. Les ouvrages qui l'abordent le font, par une contrainte évidente de place, de façon très ponctuelle et fragmentaire, en isolant quelques exemples frappants pour illustrer leur propos : aucune étude sur toute la longueur de l'œuvre, mesure après mesure, n'a été publiée, pour ce que j'ai pu en voir. Par ailleurs, lorsque ces questions sont abordées, c'est souvent de façon assez technique, sous-entendant une connaissance préalable de la théorie musicale.
Mon projet était donc de proposer une approche aussi exhaustive que possible, qui commente l'intégralité de la partition et non seulement des moments significatifs, afin de bien prendre la mesure de la dimension structurante et de la récurrence des motifs ; et cela tout en explicitant à chaque fois les événements dans un langage vulgarisé, accessible même sans lire la musique. (C'est toujours un défi pour l'harmonie, sujet autoréférentiel s'il en est, mais pas impossible en expliquant la fonction « mécanique » ou expressive des couleurs et attractions.)
J'ai ainsi tâché de tenir un double objectif qui, à mon sens, peut être fécond : d'une part être aussi complet et minutieux que je le puis, en relevant chaque occurrence que je peux rencontrer. Le format feuilleton le permet bien, surtout que les titres et descriptions peuvent orienter les curieux qui seraient intéressés par une parenté, un aspect en particulier. D'autre part rendre la série accessible à tout mélomane qui aurait simplement entendu l'œuvre, sans connaissances préalables, y compris solfégiques.
2) Le format vidéo permet un déroulé très progressif et précis de la pensée musicale : on peut reprendre plusieurs fois le même motif, le faire tourner, le décomposer. Ce n'est pas infaisable du tout en notule, mais la longueur extrême du découpage en fragments et de la mise en forme limite mécaniquement l'explication, la reformulation. Sous forme de notule, la série sur le Freischütz aurait pris au moins une centaine d'heures de travail (et je pense davantage), assez fastidieuse de surcroît (planifier tous les extraits, les enregistrer, faire de même avec les partitions à mettre en regard, tout organiser et mettre en page...).
Le plus probable est que j'y aurais finalement renoncé – près d'un an après avoir conçu le projet, alors que j'avais relevé toutes les références que je voulais mettre en évidence, je n'avais toujours pas achevé la simple récolte d'extraits sonores, encore moins des fragments de partitions, et rien de la rédaction. Dans le meilleur des cas, vous auriez eu une notule de ce genre tous les deux ans, au lieu d'avoir tout de suite, ici, deux séries ambitieuses intégralement disponibles en l'espace de quelques mois.
3) Le fait de jouer soi-même les extraits permet de ne pas dépendre des prises de son (à l'orchestre, on n'entend pas toujours bien les parties intermédiaires), de posséder les droits des extraits (la notule n'est pas dépendante d'une potentielle réclamation), et surtout de pouvoir détailler des éléments en les isolant (telle mélodie cachée dans l'ensemble, comme le thème de la forêt lointaine dans Pelléas, souvent indiscernable lorsqu'il se mêle à d'autres accords). Ce peut être utile pour rendre accessible l'explication harmonique, par exemple : si on ne le sort pas de son contexte immédiat et touffu, seuls ceux qui savent déjà pourront comprendre.
Par ailleurs, je trouve l'aspect « conversation autour d'un piano » plus convivial qu'une simple « conférence », surtout avec ce format rudimentaire en plan fixe. C'est un peu d'animation. (Et je trouve très sympathique, comme pour la série Musique en Ukraine, le côté artisanal de tout faire : recherche, textes, exécution musicale, captation, montage. L'impression de dorloter mon lectorat / spectatorat.)
B. Réception
Je suis impressionné de constater des statistiques confidentielles mais régulières, avec un petit noyau de passionnés qui suivent tout. C'est plus que je n'en espérais – je comptais simplement le déposer là, si jamais quelqu'un était intéressé, moi ça m'amuse à produire et j'avais, pour Pelléas, de toute façon prévu d'en explorer la structure pour mon usage personnel avec ou sans notule ! –, quelques dizaines pour chaque vidéo, et des retours, des commentaires positifs, même quelques purulents qui attendent chaque nouvel épisode. Et j'imagine que les statistiques gonfleront un peu au fil des mois, puisque j'ai beaucoup publié (et peu annoncé) ; tout le monde ne peut pas suivre le rythme, et tout le monde ne regardera pas tous les épisodes.
J'ai aussi essayé, comme produit d'appel, les shorts. L'idée était de profiter de l'algorithme de YouTube (je ne me suis pas épuisé à dupliquer sur d'autres plates-formes, l'objectif n'est pas de faire des vues, et j'imagine que ce sera plutôt regardé par une fraction de ceux qui ont déjà l'habitude de lire le site) pour attirer quelques curieux supplémentaires. Ce ne sont que des fragments d'une minute, très faciles à produire (il suffit de sélectionner le passage dans la vidéo d'origine et hop, le short est créé), pas du tout montés, donc pas réellement des raisonnements complets, juste des instantanés (que je prends très peu de temps à sélectionner, donc un peu arbitraires).
Quelle ne fut pas ma surprise en constatant les chiffres hallucinants de leur visionnage : souvent plus de 1000 ou 1500, et même l'un d'eux (pas spécialement le plus spectaculaire ou intéressant) à plus de 6000 spectateurs. Absurde.
J'imagine que l'algorithme refourgue ça aux gens qui regardent de la musique pour piano, ça doit entrer dans une case où ils manquent d'offre… Ça n'a d'ailleurs pas vraiment d'effet sur la chaîne (vues, abonnements sur les autres vidéos), mais c'est assez déconcertant, un peu comme les fausses musiques ou les chansons interprétées par des avatars qui submergent les plates-formes de musique et de vidéo – je doute que ça touche vraiment son public, même s'il y a en effet des likes et des réactions positives (que je ne m'explique pas trop).
En somme, il existe un public, même si moins vaste (pour ceux réellement intéressés) que pour les notules, et cela me permet d'opérer un travail de documentation parallèle à ce qui est fait à l'écrit sur le site, avec un effort de production et une chronophagicité bien moindres. La possibilité de communiquer sans effort sur des sujets que je tiens par-devers moi depuis des années, impressionné par l'énergie nécessaire pour sa présentation et sa rédaction, rend même la facilité de ce nouveau format un peu grisante !
C. Productions futures
À présent que la série Freischütz est achevée, avec quoi faire alterner la série Pelléas ?
Pour situer : l'idée est plutôt de ne pas refaire des notules existantes – moins stimulant pour moi, et vu que les vidéos font beaucoup moins de lectures que les notules, pas sûr que ce soit une contribution essentielle –, et de privilégier les sujets où la plus-value de jouer des extraits en direct est la plus évidente. Donc pas de commentaires discographiques, par exemple. (Pour ce format, j'aimerais plutôt le faire avec des amis, ce pourrait être sympathique, je pose ça là, n'hésitez pas à me signaler si vous êtes tentés, par exemple les dernières trouvailles discographiques, nouveautés ou non, ou conseiller des découvertes par thème…)
Je m'interroge.
¶ La suite des leitmotive ? Je ne voudrais pas faire que cela sur la chaîne, mais il y a encore quelques beaux candidats. J'aurais beaucoup aimé faire Arabella de Richard Strauss, peut-être l'exemple le plus vertigineux que je connaisse en la matière ; mais je crains de tomber exactement dans un creux entre deux formats : peu de monde connaît déjà suffisamment l'œuvre pour disposer d'un public minimal, et ce n'est pas non plus une découverte d'œuvre qui pourrait attirer un autre type de curieux. Tosca de Puccini paraît un candidat plus fructueux : tous les amateurs d'opéra le connaissent, et on l'écoute rarement en soulignant cet angle (pourtant il y a là aussi des motifs partout, même si les concaténations et mutations y sont assez peu spectaculaires par rapport à nos précédents exemples francogermaniques). C'est par ailleurs très agréable à jouer et il y a de jolies choses à dire.
Dernière possibilité, L'Aigle de Jean Nouguès, un inédit qui n'a pas vocation dans une telle série à être joué en entier, mais dont je pourrais détailler des extraits significatifs : variations & fugato sur la Chanson de l'Oignon, empilement de chants révolutionnaires, consulaires & impériaux qui constituent, retravaillés, l'essentiel de la matière musicale de l'opéra ! – La Carmagnole, Ah ça ira, Nous n'irons plus au bois, Il était un petit homme tout habillé de gris, Veillons au salut de l'Empire, Marche consulaire de Marengo, Le Chant du Départ, La Marseillaise… J'en ai déjà capté deux épisodes, je trouve cette musique vraiment incroyable ; mais je ne suis pas certain que ce type de travail de détail sur un inédit puisse réellement toucher son public. Je suis curieux des retours, je publierai probablement ça avant la fin de la série Freischütz, afin de recueillir des retours et des statistiques. Dans ce même esprit, il y a La Glaneuse de Félix Fourdrain, un drame naturaliste particulièrement intense et inspiré, mais pour profiter des motifs, il faudrait tout jouer, et on retomberait un peu dans l'esprit des « déchiffrages filmés », dont il reste un peu difficile de s'emparer, je trouve – j'adore faire ça, mais je ne pense pas que ce soit ce qui apporte le plus aux visionneurs.
¶ Une autre grande série thématique ? Par exemple la suite de la série ukrainienne. (Mais ce sera davantage enregistrer des pièces de musique avec du contexte et moins du commentaire de détail.) J'ai quelques bijoux inédits de Bortniansky et d'Akimenko sous le coude, par exemple. Et je serais ravi de parler de Mosolov, Roslavets, Ornstein…
Ou bien une série sur les chants de la Révolution et leur usage musical, sans doute pas mal à chercher et à montrer, et accessible à un vaste public ! À étendre peut-être à l'exploration du style révolutionnaire.
Problème : beaucoup d'œuvres ne sont pas aisément disponibles en partition par mes réseaux habituels. Pourquoi pas sous forme assez courte : je donne un peu de contexte sur le compositeur (et éventuellement les enjeux de son attribution nationale), je joue une pièce, je souligne quelques-unes de ses caractéristiques intéressantes.
¶ Des inédits décortiqués, quelque chose d'équidistant entre mes déchiffrages filmés et l'approche minutieuse de Pelléas : vraiment donner la becquée au public pour pouvoir s'approprier une œuvre inconnue. C'est que j'ai été bouleversé par Le vieil Aigle de Raoul Gunsbourg à chaque lecture, combinaison d'un livret simple mais bouleversant, et d'une musique intelligente qui va droit au but et touche juste à chaque fois. Mais idéalement, il me faudrait le concours, sinon de chanteurs, de récitants. (Et bosser quelques passages périlleux, ça se lit à vue sans effort et sans chausse-trappe la plupart du temps, mais il y a des marines assez virtuoses à des moments critiques qu'on ne peut pas affaiblir sans diminuer l'œuvre elle-même.)
Vercingétorix de Félix Fourdrain pourrait aussi intéresser un public assez vaste, j'avais commencé à en diffuser le déchiffrage avec des commentaires (1,2), parmi les premières vidéo de déchiffrage de la chaîne. Et cela dépasse la musique (leitmotive également, couleurs harmoniques, etc.), puisque cela entre évidemment en résonance avec nos interrogations actuelles sur les évolutions et l'usage du roman national.
Plus simple à réaliser, car plus court (et déjà un peu travaillé), une version vidéo et commentée de la Symphonie de la Tour Eiffel d'Adolphe David, mon étrange trouvaille d'il y a deux ans.
¶ Ou encore (et cela adviendra sûrement à un moment ou un autre), des épisodes isolés, sur des remarques précises. Là tout de suite, je pense à des choses aussi disparates que des trouvailles dans des inédits ou des détails d'architubes. D'une part, représentation d'une troublante justesse des viols de guerre à la fin de l'acte II d'Ivan le Terrible de Raoul Gunsbourg – qui fut médecin de guerre du côté russe contre les Turcs, et même un contributeur actif à la victoire de Nikopol. D'autre part, les détails qui répondent à la question Pourquoi Mozart est-il aussi génial ?, les mutation du motif pointé initial dans le mouvement lent de la Quatrième Symphonie de Beethoven (avec un solo de timbale à peu près totalement inédit, je crois, hors concertos et roulements), l'usage des modulations pour varier les éclairages et les émotions dans Die Winterreise de Schubert… Donc différents degrés de découverte un peu inédite ou au contraire de vulgarisation.
Bien sûr, s'il y a des avis et des souhaits dans cette liste ou hors liste, je prends note ! Vu le faible nombre de personnes concernées, deux ou trois demandes convergentes peuvent valoir commande. Pour l'heure, la principale suggestion convergente, de plusieurs regardeurs, portait sur un décorticage de Wozzeck de Berg sur le modèle de Pelléas – mais j'ai poliment décliné pour l'instant, cette musique m'affecte tellement violemment que si je mets le nez dedans au quotidien, cela va littéralement ruiner ma vie.
D. Le contenu
Cette notule a été longue à paraître parce que je ne souhaitais pas me contenter d'une autopromotion satisfaite, l'idée est tout de même de fournir un peu de contenu informatif.
Par conséquent, à présent qu'on a réalisé le petit tour d'horizon du principe (et des prochains thèmes), comme je ne voudrais pas avoir l'air de dépouiller le site en renvoyant simplement aux contenus vidéo, je vous propose ici une petite table des matières. Ainsi vous pourrez retrouver, même sans regarder les vidéos, les contenus des investigations et les moments où chercher dans la partition. (C'est tout de même plus facile en regardant, évidemment.)
Dans les deux séries, ce sont des vidéos de 20 à 40 minutes : dans l'idée d'être assez long pour pouvoir développer le propos, mais assez bref pour rendre l'ingestion en une seule fois indolore.
Série Leitmotive de Pelléas
Publication :
Tous les samedis.
Présentation :
« Série consacrée à la structure en leitmotive – très dense, davantage encore que dans le Ring selon les scènes ! – de Pelléas & Mélisande de Debussy. »
Et cela va à l'encontre de ce que l'on entend le plus souvent sur Debussy (coucou Pierrot), peut-être pour avoir pris trop au sérieux les propres déclarations du compositeur.
La playlist leitmotive pour retrouver toutes les vidéos.
Les notules autour de l'œuvre – les dernières abordent précisément cette question.
Épisodes :
1. « Allemonde ou la forêt lointaine ? ». Dans ce premier épisode, apparition d'un premier motif (Allemonde ? la forêt ? les temps lointains et mystérieux ?). Opposition (stylistique, mais aussi modale) au motif de Golaud.
2. « Golaud et les destructions de la gamme par tons ». Dans ce deuxième épisode, apparition du motif de Golaud. Ses composantes. La gamme par tons et ses conséquences destructrices pour la tonalité.
3. « Motifs attachés à Mélisande ». Dans ce troisième épisode, apparition du motif principal de Mélisande. Mais ce n'est pas du tout celui qui la caractérise le plus souvent dans cette première scène ! Plutôt ceux attachés au désir de Golaud pour elle et au rejet de Mélisande envers lui (ou au passé de Mélisande ?).
4. « Entrée de Golaud (chasse, première superposition…) ». Dans ce quatrième épisode, le rideau est levé et Golaud prononce sa première réplique ! On observe comment les deux premiers leitmotive de l'opéra (la forêt lointaine & Golaud) vont déjà se superposer.
5. « Comment délimiter les motifs ? » Dans ce cinquième épisode, on se pose la question de la limite entre un élément identique au motif (intervalle mélodique, rythme) et la volontaire référence à ce motif par Debussy. Pas toujours facile.
Moment : fin de la première tirade de Golaud.
6. « Motifs du désir, du rejet, de la couronne… et premières fusions ! » Dans ce sixième épisode, on découvre le motif du désir de Golaud, celui du rejet de Mélisande, celui de la couronne… et on observe déjà des mutations impressionnantes où leurs caractéristiques respectives se mêlent.
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « J'entends pleurer » à « Y a-t-il longtemps que vous avez fui ? ».
7. « Le "vrai" motif Allemonde et... Tosca ! ». Dans ce septième épisode, on explore le figuralisme de la couronne, les mutations du motif de Mélisande, et on parle un peu de Boris Godounov et de Tosca.
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau » à « Si, si, je les ferme la nuit ».
8. « Boris Godounov (et syncopes, accompagnements, fusions...) ». Dans ce huitième épisode, on observe la suite des fusions des motifs et des naissances de nouveaux... et l'on explore la fameuse parenté avec Boris Godounov de Moussorgski. (Tout en annonçant celle entre le motif initial de la forêt et un extrait mineur des Huguenots de Meyerbeer.)
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Pourquoi avez-vous l'air si étonnée » à « Je n'en sais rien, je suis perdu aussi ».
9. « Rivalités de sopranes, procès, duel, Huguenots, portraits de Mélisande ». Un neuvième épisode assez dense : on regarde la citation (involontaire) des Huguenots en examinant les hypothèses de cette parenté, on rappelle la genèse de Pelléas (le blanc-seing de Maeterlinck et le procès perdu, la compétition entre les sopranos Germaine Leblanc et Mary Garden, la question de la diction, la provocation en duel, l'assassinat de la chatte de Maeterlinck…), et on se pose aussi la question des interprétations possibles du personnage de Mélisande (fillette, victime, coquette, vouivre ?). Tout en poursuivant notre avancée chronologique sur les motifs.
Moment : acte I scène 1 « La nuit sera très noire et très froide », puis début de l'interlude entre les scènes 1 & 2.
10. « Sommeil de Brünnhilde et hallucinations de Boris Godounov ». Dans ce dixième épisode, on regarde la version longue du premier interlude, et on observe les réminiscences de fragments du sommeil de Brünnhilde et des hallucinations de Boris Godounov.
Moment : acte I, interlude entre les scènes 1 & 2.
11. « Apparition de Parsifal ». Ce onzième épisode est l'occasion d'explorer de près la fameuse référence à la marche qui ouvre et innerve la première musique de transformation de Parsifal : contrairement à ce que suggèrent beaucoup de résumés de cette affaire, cette cellule est déjà présente dans la version courte de l'interlude entre les deux premières scènes de Pelléas ! Mais elle est plus développée, et encore plus proche, dans sa version longue, ce qui explique les remarques soulignant qu'un Debussy pressé écrit du Wagner – rappelez-vous, Albert Carré, directeur de l'Opéra-Comique, commande l'allongement des interludes, trop brefs pour la machinerie de scène, mais seulement au moment les répétitions, quelques semaines avant la première (et Debussy lui répond en substance qu'il ne peut pas écrit de musique au kilomètre). C'est pourquoi on retrouve dans les (incroyables) interludes longs beaucoup de matière issue des différentes scènes de l'opéra, parfois sans lien direct avec les scènes entre lesquelles elle se trouve (il faut y prendre garde lorsqu'on feut faire l'exégèse du sens des motifs !
Comparaison des deux interludes en fin d'épisode.
Moment : interlude long (version définitive après répétitions de 1902) et interlude court (version d'origine avant répétitions) entre les scènes 1 & 2.
12. « La lettre & la généalogie ». Ce douzième épisode tourne autour de la lecture de la lettre par Geneviève. On met le doigt sur un motif qui pourrait lui être lié (et manifestement parent du motif du « monde lointain » qui ouvre l'opéra), on réentend quelques suggestions évoquant la forêt du début ou Mélisande ; mais domine surtout la sobriété, qui accentue cette impression de hiératisme propre à ce Moyen Âge de fantaisie.
On pose aussi la question de la généalogie. Geneviève est-elle la mère de Golaud & Pelléas ? Est-elle la fille d'Arkel ou issue de l'alliance avec une famille extérieure ?
Moment : I,2. Lecture de la lettre.
13. « Arkel, la guerre, le réel, Dieu, les neumes ». (Parution le samedi 5 juillet.) Ce treizième épisode explore la tirade d'Arkel :
b) Éléments de réalité (ici, la guerre) qui affleurent dans l'univers éthéré de Pelléas. Cf. cette notule.
3) La place de Dieu dans Pelléas. Cf. cette notule.
14. « Pelléas-personnage, la jalousie, le danger ». (Parution le samedi 12 juillet.) Ce quatorzième épisode dévoile plusieurs motifs importants :
b) celui lié à la jalousie et aux tentations de violence de Golaud (ces octaves ascendantes) ;
c) une couleur spécifique liée au danger (au destin ?) en plusieurs endroits.
15. « Interlude n°2 (long et court), harmonie parsifalienne, retour du désir ». (Parution le samedi 19 juillet.) Ce quinzième épisode explore la version courte et la version longue du deuxième interlude de Pelléas, avec notamment :
b) retour du motif du désir, intégré et retravaillé.
16. « Sombre ou clair ? ». (Parution le samedi 26 juillet.) Ce seizième épisode se concentre sur le contraste obscurité / lumière, et la nature de motifs d'accompagnement, qui s'oppose à la réutilisation de motifs récurrents :
b) motif de Pelléas qui intervient au moment où il est question de la clarté, avant même que le bruit de ses pas ne soit évoqué ;
c) poussée harmonique et illumination d'accords « purs » de trois sons (procédé pour figurer la lumière ?).
17. « Les marins : Golaud ou la mer ? ». (Parution le samedi 2 août.) Ce dix-septième épisode s'esbaudit de l'ambiguïté, dans toute la scène du navire qui sort du port, du motif de Golaud – qui paraît aussi un motif de la mer :
b) contraste de formules ténébreuses (« il y a encore une brume sur la mer »), avec ces accords dans le grave prodigues en quintes directes, et des motifs lumineux (« le navire est dans la lumière », avec ses triolets pépiants), qui ne constituent pas nécessairement des motifs récurrents (à surveiller pour la suite) ;
3) superposition du choeur des martins, des motifs de Mélisande, de Golaud, et de la formule d'accompagnement du début de la scène, tout cela simultanément avec des répliques de personnages.
18. « II,1 : motifs aquatiques, Pelléas qui affleure, Fiodor Godunov... ». (Parution le samedi 9 août.) Ce dix-huitième épisode suit l'apparition des premiers motifs de l'acte II :
b) liquidités aquatiques sur plusieurs motifs (pas nécessairement récurrents) ;
c) les accords d'Allemonde / d'Arkel / du destin, pour la « fontaine miraculeuse » ;
d) le motif de l'eau silencieuse, avec ses acciaccatures, qui impose à chaque fois une rupture harmonique très soudaine ;
e) une parenté étonnante entre le motif liquide de l'eau (les petites volutes descendantes) et la scène où Fiodor, fils de Boris Godounov, étudie la géographique (chez Moussorgski, donc).
19. « L'arbitraire de l'harmonie coloriste, dialogues avec Ernest Guiraud ». (Parution le samedi 16 août.) Ce dix-neuvième épisode poursuit l'exploration du matériau du premier tableau de l'acte II. On s'y attarde, autour du motif de l'eau étale et silencieuse, sur le caractère coloriste plutôt que fonctionnel d'une partie des enchaînements d'accords chez Debussy. (À travers notamment ses conversations avec son maître Ernest Guiraud, le compositeur des récitatifs de Carmen et des Contes d'Hoffmann, dépositaire d'un langage plutôt conservateur – telles que notées par Maurice Emmanuel, camarade et ami de Debussy.)
Moment : II,1 (suite).
20. « Souvenir de la rencontre, l'anneau & les symboles ». (Parution le samedi 23 août.)
Ce vingtième épisode aborde la conversation sur la rencontre de Mélisande avec son futur mari, sur un soubassement obstiné de fragments du motif-de-Golaud. On y rencontre le motif de l'anneau, on se pose la question sur son importance symbolique, encore plus évidente dans le tableau suivant, où Golaud semble comprendre que, dans un drame symboliste, l'objet a autant de valeur que la chose même – et que perdre l'anneau, c'est perdre le lien, perdre son empire sur sa femme. [Un forum entier est dédié à cette question.]
On s'intéresse aussi aux motifs aquatiques, pas forcément transversaux dans l'opéra (donc pas toujours des leitmotive), qui parcourent toute la scène.
Moment : II,1. Le souvenir de la rencontre avec Golaud et la perte de l'anneau.
Je dois enregistrer demain les épisodes 21 (comparaison des interludes entre II,1 et II,2, la version longue est vraiment plus généreuse et étrange) et 22 (début de II,2, la blessure de Golaud). L'aventure se poursuit !
--
Série Fortune du Freischütz
Publication :
Tous les mercredis.
Présentation :
« Le principe de cette série ? Explorer les influences considérables de la scène de la Gorge du Loup sur les compositeurs du XIXe siècle – jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'en Russie ! »
La série est désormais achevée, 16 épisodes qui seront diffusés jusqu'à mi-septembre ; vous pouvez en retrouver la playlist ici.
En jouant une poignée de fois, pour mon édification personnelle, la scène de la Gorge du Loup – il y a un an environ – j'ai été frappé par le nombre de correspondances qui s'imposaient dans mon esprit : Mendelssohn, Marschner et Wagner, en bonne logique, mais aussi Schubert, Meyerbeer, Halévy, Berlioz et même Tchaïkovski ! C'est ainsi que m'est venu l'envie de faire remarquer la densité de cette scène en matériau, à peu près inédit à l'époque de la création, qui est ensuite devenu le langage commun à toute l'Europe symphonique !
L'autocitation, aussi, à ce degré, c'est peut-être une première ; et cela ouvre la voie ensuite aux versions altérées de ce genre de répétitions – les leitmotive. Les plus frappants éléments précurseurs que je connaisse autrement se trouvent dans les Huguenots, très ponctuellement (et 15 ans plus tard !).
Épisodes :
→ Explication de la question du référentiel musical (« la tonalité pour les nuls »).
→ L'usage dramatique du trémolo depuis Gluck.
→ Différences pratiques et esthétiques entre le trémolo de cordes et celui au piano.
→ Les choix d'orchestration. L'histoire du trombone dans l'orchestre classique (à l'Opéra).
→ Le principe du chromatisme.
2. « Les portails de téléportation (ou quintes diminuées) ». Dans ce deuxième épisode :
→ Les cris de chanteurs hors scène, avec rappel de l'histoire du chant choral hors scène et de la transgression, ici spectaculaire, des tessitures.
→ Dichotomie majeur / mineur.
3. « Fantastique, paternités musicales & autres contraintes, opéra allemand ». Ce troisième épisode pose quelques grandes questions générales sur la musique :
→ Comment déterminer la paternité musicale d'une invention sonore ? Les précautions à prendre.
→ Contraintes intrinsèques de la grammaire musicale : faute de référent concret (la musique ne décrit rien), les possibilités de rupture sont limitées sans perdre totalement le lien avec les émotions du public.
→ Rapide rappel de l'histoire de l'opéra allemand.
4. « Influences sur La Walkyrie & Dalibor (Smetana), le mélodrame musical ». Dans ce quatrième épisode :
→ Chœur de spectres qui sert de matrice au chœur du public au procès de Dalibor, chez Smetana.
→ Accords de tension et ponctuations de timbales dont procèdent manifestement l'Annonce de la mort (Todverkündigung) dans Die Walküre de l'horrible Richard Wagner.
5. « Matrice de La Juive, de Don Carlos ; refontes de Castil-Blaze, Berlioz… ». Dans ce cinquième épisode :
→ Apparition d'accompagnement / transition en accélération, comme on en trouve dans « Toi qui sus le néant » / « Tu che le vanità » de Don Carlos de Verdi.
→ Succès européen du Freischütz, et notamment les adaptations françaises – le Robin des Bois de Castil-Blaze, la version avec récitatifs de Berlioz, ou encore Durdilly, le pote de Gounod.
6. « Arabella de Richard Strauss ». Dans ce sixième épisode :
7. « Robert le Diable de Meyerbeer ». (Parution programmée le mercredi 9 juillet.) Dans ce septième épisode :
→ Les leitmotive, dont l'embryon apparaît chez Weber puis Meyerbeer.
8. « Autocitation, Mozart, Mendelssohn, Berlioz, Tchaïkovski ». (Parution programmée le mercredi 16 juillet.) Dans ce huitième épisode, pléthore de parentés en à peine quelques mesures :
→ source de l'orchestration des bois chez Mendelssohn (A Midsummer Night's Dream) et Tchaïkovski (Roméo & Juliette) ;
→ source de l'imaginaire de la cavalcade dans La Damnation de Faust de Berlioz ;
→ à nouveau Meyerbeer ;
→ autocitation et naissance du leitmotiv.
9. « Le Vampire & le Hollandais volant ». (Parution programmée le mercredi 23 juillet.) Dans ce neuvième épisode :
→ source de plusieurs effets utilisés dans Der fliegende Holländer de Wagner ;
→ usage du cor.
10. « Autocitations & Vaisseau fantôme ». (Parution programmée le mercredi 30 juillet.) Dans ce dixième épisode :
→ autocitation du motif de la dérision de Kaspar et de celui de la scène de dérision du village qui ouvre l'opéra ;
→ trémolos et harmonies comparables à Der fliegende Holländer de Wagner.
Moment : Max arrive en haut de la cascade qui domine la Gorge du Loup, et hésite à rejoindre Kaspar.
11. « Auf dem Wasser zu singen (!) & autocitations ». (Parution programmée le mercredi 6 août.) Dans ce onzième épisode :
→ autocitation de l'air de Max ;
→ effets de circulation du matériau thématique dans l'Ouverture.
12. « Oiseaux de nuit berlioziens & chromatisme huguenot ». (Parution programmée le mercredi 13 août.) Dans ce douzième épisode :
→ retour du motif de Samiel (parent du Destin et de l'Annonce de la mort dans La Walkyrie de Wagner) ;
→ disposition d'accords, rythmes et orchestration de l'évocation des oiseaux de nuits, très similaire à celle de Berlioz dans sa Course à l'Abîme de la Damnation de Faust.
13. « La jeune Fille & la Mort, le Winterreise et… Armide de LULLY ». (Parution programmée le mercredi 20 août.) Dans ce treizième épisode :
→ un clin d'œil à la Passacaille d'Armide de LULLY.
14. « Sources littéraires & création "dans le noir" ». (Parution programmée le mercredi 27 août.) Dans ce quatorzième épisode :
→ état initial du livret (duo liminaire entre Agathe et l'Ermite) ;
→ vedettes présentes dans la salle (Heine, Hoffmann, Mendelssohn !) ;
→ évolution de la commande (de Dresde à Berlin) et opinion de Weber.
15. « Chasseurs damnés, Vaisseau fantôme, références déformées de l'Ouverture ». (Parution programmée le mercredi 3 septembre.) Dans ce quinzième épisode :
16. « Orage final : follets Nonnes damnées, feu de Wotan, cabalette Vampyr ». (Parution programmée le 10ercredi 3 septembre.) Dans ce seizième (et dernier) épisode :
→ feux follets du début du ballet des Nonnes damnées dans Robert le Diable de Meyerbeer ;
→ apparitions de Loge & enchantement du feu de Wotan pour le sommeil de Brünnhilde ;
→ cabalette d'Aubry dans Der Vampyr de Marschner ;
→ conclusion générale sur l'impact de cette scène dans l'imaginaire musical européen.
--
« Série révolutionnaire » : usage de chants révolutionnaires, consulaires & impériaux comme leitmotive
Parmi toute la liste des sujets possibles, j'avais très envie de proposer au moins des fragments (je doute que davantage que quelques épisodes puisse trouver un public de plus de deux personnes) de L'Aigle de Jean Nouguès, un opéra à la gloire de Napoléon, avec un livret lourdement hagiographique, mais une musique d'un esprit incroyable : l'essentiel de la matière musicale repose sur l'usage, la concaténation, la superposition, la mutation de chants traditionnels ou patriotiques. Ah ça ira, La Carmagnole, Le Chant du Départ, La Marseillaise, Marche consulaire de Marengo, Veillons au salut de l'empire, Nous n'irons plus au bois, Il était un petit homme tout habillé de gris… Et bien sûr, au sommet, cet interlude orchestral en forme de variations sur J'aime l'oignon frit à l'huile !
Épisode 1 – l'interlude de l'Oignon, avant le tableau de Marengo.
Épisode 2 – début de l'opéra et premières superpositions (quelquefois la seconde moitié du chant se superpose sur lui-même !).
Pour l'instant, deux épisodes captés, que je diffuserai sans doute très prochainement, afin de disposer d'un premier retour en commentaires ou en statistiques et de décider de la prochaine série au long cours.
Tiennent la corde pour l'instant : les leitmotive de Tosca, l'usage des chants révolutionnaires, la série ukrainienne. Mais qui sait ?
--
À bientôt pour de nouvelles aventures (écrites) !
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Autour de Pelléas et Mélisande a suscité :
silenzio :: sans ricochet :: 112 indiscrets