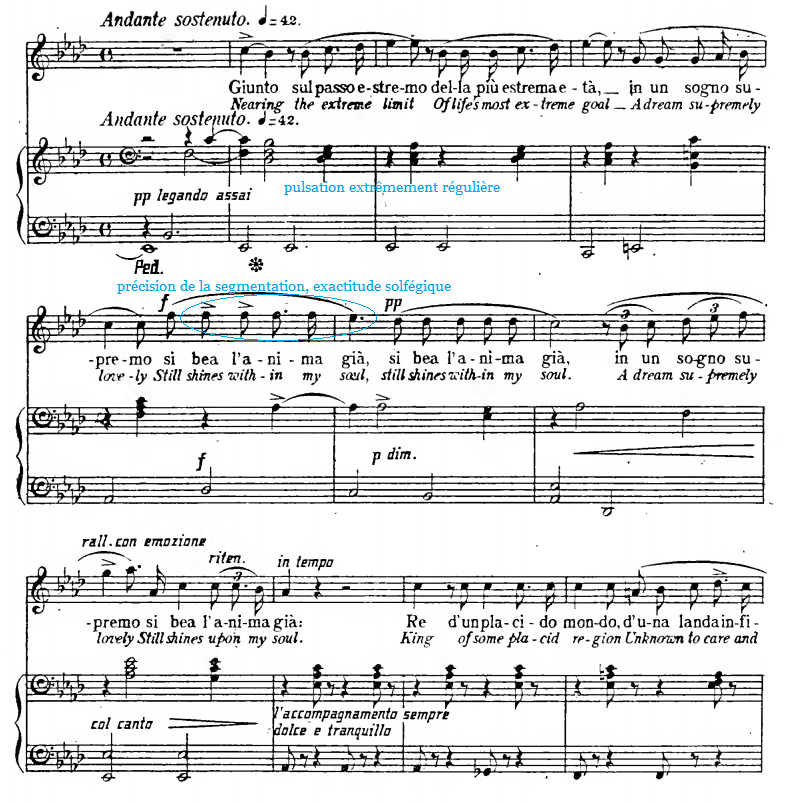L'opéra italien, en plus de constituer à la fois l'origine et
l'étendard du genre, est bien sûr majoritaire à l'échelle mondiale ;
surtout grâce à Mozart-Verdi-Puccini, mais cela n'exclut pas la
présence de
raretés parfois assez stimulantes.
En rouge, les
recommandations
personnelles – non pas qu'il soit conseillé de prendre l'avion pour un
seria
(possiblement interchangeable), mais disons que si on les apprécie,
dans le genre rare et abouti, on peut au moins trouver son compte en
allant en écouter un disque ou une bande !
Avant de commencer, pour une vue plus globale de l'histoire de l'opéra
italien, et de ses enjeux à travers ses différentes périodes et
esthétiques, vous pouvez vous reporter à
cette notule.
Opernhaus de Wuppertal (Est de Düsseldorf, sur la route
de Dortmund), où l'on jouera Francesca Caccini. Moche, mais un théâtre
à l'italienne où l'on est partout de face (et capitonné bois) est une
si belle utopie !
1. Opéras baroques de
première génération
De'
Cavalieri : La
Rappresentazione di Anima, e di Corpo (Théâtre Musical des Enfants à
Moscou)
→ Oratorio en réalité ; ces dialogues
allégoriques (et même prosopopéisants) sont restés en vogue jusqu'au
début du XVIIIe siècle dans les compositions (semi-)religieuses – pas
exécutées pour un office, mais ce ne sont pas fictions conçuespour le
divertissement.
→ L'œuvre a connu ces dernières années une certaine fortune (Savall,
Pluhar, Jacobs en ont proposé des versions très élaborées)
F. Caccini : La liberazione
di Ruggiero dall'isola d'Alcina (Wuppertal)
→
Donnée en tournée par l'ensemble Huelgas (qui doit le publier), et
récemment documenté pour la première fois au disque
par Sartori (chez Glossa). D'assez loin
un
des opéras les plus réussis de la période,
avec un des livrets les plus littéraires de tout l'opéra italien, des
psychologies détaillées dans une belle langue, un très beau sens
musical des flux de parole, des harmonies simples mais plus colorées
que chez la plupart des contemporains.
Teatro Rossini de Lugo (Est de Bologne, Ouest de
Ravenne), où l'on donnera Orlandini.
2. Opéras baroques
d'esthétique seria
♦ On peut commencer par lire ces
anciennes notules autour des principes de l'opéra seria et
des néo-chapons, qui expliquent certaines des
réticences que je ne vais pas manquer d'exprimer çà et là. Que
cela ne vous décourage nullement, tout dépend évidemment des
composantes auxquelles vous êtes le plus sensible à l'opéra !
[Par
ailleurs, c'est l'opéra baroque – et d'abord le seria – qui m'a fait aimer l'opéra,
aussi ne voyez rien de rédhibitoire dans ces réserves…]
|
Albinoni, Zenobia, regina
de' Palmireni (Venise)
→ Considérant que l'Adagio en si mineur n'a jamais été
réellement cru de lui, seuls les mélomanes baroqueux un peu chevronnés
ont vraiment entendu Albinoni. Il y a de jolies choses, plus
typiquement baroques que les
compositions de Remo Giazotto, forcément – pas toujours sans parenté au
demeurant (et pour cause: l' Adagio
part d'emprunts de mélodies et de basses à Albinoni, même si son
orientation est néo-baroque un peu romantisante, à la façon des
pastiches des Casadesus).
→ Zenobia est un témoignage
très intéressant de la période intermédiaire qui emmène l'opéra
purement déclamatoire de Monteverdi puis Cavalli à l'opéra seria.
On sent qu'on est déjà après la période Legrenzi (1694), et les lignes
vocales sont déjà très ornementées, mais on y trouvera aussi quelques
beaux récitatifs assez mélodiques, des accompagnements qui dialoguent
avec les chanteurs (plutôt que la compétition simultanée de virtuosité
comme c'est ensuite l'usage). Par ailleurs, une jolie inspiration
mélodique : ce n'est pas toutà fait le seria du XVIIIe, et c'est plutôt
plus sobre et plus libre.
Haendel, Almira (Boston)
Haendel, Scipione (an der Wien)
Haendel, Riccardo Primo (Madgebourg)
Haendel, Berenice (Halle)
|
→ Quatre
opéras peu donnés, pas nécessairement des chefs-d'œuvre néanmoins –
j'ai ainsi été fort peu impressionné par Richard Ier (Cœur de Lion), malgré
le sujet original (histoire médiévale, et même pas par le biais
littéraire
du Tasse ou de l'Arioste). La réalisation musicale m'en paraît assez
peu
exaltante, peu d'airs saillants, pas vraiment de tension dramatique non
plus – il est vrai que la version discographique longtemps unique, de
Rousset, expose
ses manques habituels dans ce répertoire (vraiment mou et translucide).
→
Almira, Königin von Castilien
est tout de même son premier opéra, mêlant allemand et italien, où
figure déjà la fameuse sarabande (d'abord instrumentale) qui sert de
base à « Lascia la spina » du Trionfo
del Tempo et « Lascia ch'io pianga » de Rinaldo.
(→ Les oratorios-opéras anglais seront traités dans la partie
anglophone du parcours.)
Orlandini,
Serpilla e Bacocco (Lugo)
→ Refonte de 1730 d'un intermezzo
comique de 1715,
par un contemporain exact de Haendel (1676-1760). Pourtant, la musique
n'en est pas du tout comparable aux opéras bouffes connus du temps : la
langue paraît déjà tout à fait classique, avec ses récitatifs secs
truculents à la façon de Mozart et Rossini, ses airs de caractère avec
notes répétées (là aussi, on songe plutôt à Paisiello et Rossini). Ce
n'est pas du tout un chef-d'œuvre ultime, mais sa langue musicale est
en avance d'une façon troublante que je ne me suis jamais bien expliqué
– sans doute est-ce une affaire de région (il est florentin, on en a
peu de célèbres à cette époque), ou d'illusion d'optique en considérant
les œuvres comiques célèbres contemporaines, pas nécessairement
représentatives.
Vivaldi,
Motezuma (Ulm)
→ L'un des tout meilleurs opéras seria
et le haut de la production de Vivaldi. Pas tant pour les airs, au
demeurant, que pour l'élan général en lien avec le livret, une façon de
tout articuler de façon inhabituellement fluide pour ce
répertoire.[Attention, au disque, Malgoire a enregistré un pasticcio avant la redécouverte de
la partition ; c'est Curtis qu'il faut écouter pour entendre la musique
d'origine.]
Zelenka,
Il serpente di bronzo
(Frankfurt-am-Main)
→ Un oratorio en réalité. Dieu envoie
une plaie – aux Hébreux qui se plaignent dans le désert – sous la forme
de hordes de serpents, puis son remède (la recette pour un serpent de
bronze qui sert d'antidote). Le langage en est typique de la période
(1730), et plutôt sombre et dense comme souvent dans le baroque
allemand de ces années. Ça ne me bouleverse pas, mais si on aime Bach
ou les airs les plus mélancoliques de Haendel, c'est assez réussi – et
en tout cas fort bien écrit.
→ Particularité : Dieu intervient en personne, sous la forme d'une voix
de basse. Assez déstabilisant d'entendre Jéhovah répéter en boucle les
mêmes mots tout en exécutant des vocalises en escalier. Mais
indubitablement divertissant.
Vinci, Siroe (Naples)
Leo,
L'Olimpiade (Naples)
|
→ Les deux Léonard napolitains
écrivaient des opéras d'un postvivaldisme particulièrement virtuoses ;
je n'ai rien entendu chez eux qui égale les meilleurs Haendel et
Vivaldi (en revanche, qui surpasse les mauvais, oui, sans difficulté),
mais je n'ai pas trop insisté : ce sont vraiment des archétypes du seria. Si l'on aime ce type de
virtuosité brillante un brin extérieure au drame, ce sont des
compositeurs au talent très sûr.
Ristori, Fidalba e Artabano (Lugo)
Pergolesi, La serva padrona (Helikon de
Moscou)
|
→ Deux intermezzi comiques. La Serva padrona,
peut-être plus célèbre pour la controverse involontaire dont elle fut
le point de départ (la « Querelle des Bouffons » de 1752…) que pour sa
musique, au demeurant délicieuse. Le sujet est comparable à Serpilla
d'Orlandini, trois ans plus tôt, avec un peu plus de comique d'intrigue
en sus des caractères (une servante opiniâtre prend le dessus sur un
maître faible, au sein d'un enjeu amoureux).
→ Ici aussi, la musique est déjà d'une grammaire pour partie assez
classique pour 1733 (sans parler des onomatopées qui feront le sel de
Rossini !), on sent très bien tout ce que lui doivent Cimarosa et
Paisiello. Au demeurant, une œuvre réjouissante où se manifestent un
très beau sens mélodique, une véritable originalité dans la
structuration des thèmes, l'aspect général de la musique, et une
jovialité particulièrement délectable.
Hasse, Siroe (Amsterdam, Mainz)
Hasse, Artaserse (Pinchgut de Sydney)
|
→ Le grand successeur de Haendel,
sensiblement sur les mêmes bases ; un peu plus virtuose que frisonnant,
sans doute, même il existe bien des pépites dans le legs – je voudrais
réentendre Cleofide dans une
belle interprétation, par exemple (le disque de Christie est assez sec
et terne).
→ N.B. : C'est l'excellent ensemble spécialiste Orchestra of the Antipodes (à
l'origine de superbes Rameau, notamment) qui officie au Pinchgut.
Le Théâtre Académique d'Opéra et de
Ballet de Saratov,
à quelques
mètres de la Volga – équidistant d'Oulianovsk (au Sud de Kazan) et de
Volgograd. On y jouera le Mariage
secret de Cimarosa – dans des conditions probablement pas très
musicologiques.Mais quelle allure de temple grec – un petit côté Lincoln Memorial !
3. Opéras classiques
♦ On a beau passer dans l'ère classique (progressivement à
partir des années 1750, et façon claire dans les années 1770), dont les
contours ne sont pas si faciles à définir (les improvisations de basse
continue persistent jusqu'à assez tard, et les genres canoniques
inchangés…), les opéras sérieux sont toujours écrits sous le format de
l'opéra
seria, avec ses
numéros clos longs et très virtuoses.
Seule
la langue musicale évolue.
Gluck,
Le Cinesi (Valencia).
→ Œuvre quasiment mythique dans la
communauté lyrique numérique francophone, à l'origine de la scission et
de l'effondrement de plusieurs vieilles maisons.
→ Pour le reste, l'étonnant témoignage d'un Gluck aux accents plus
guillerets, dans lequel demeurent encore des traits de la période
précédente (on est en 1754, et les traits de basson ramistes de
l'Ouverture !). Les récitatifs secs en sont très longs (et peu
passionnants), les accompagnements « affectifs » plus tournés vers le
style classique, les tapis de trémolos et les pointés de cor déjà
fréquents, mais ce reste une œuvre d'ambition limitée.
Traetta, Antigona (Osnabrück, Oldenburg)
→
Antigona (1772) est déjà
marquée par les innovations gluckistes qui se manifestent dans des
opéras italiens dès les années soixante, avec
Orfeo ed Euridice (1762) et
Alceste (1767), bien avant la
réforme musicale française qui advient avec
Sabinus de Gossec (1773) et
Iphigénie en Aulide de Gluck
(1772). [Pour les détails sur ces questions, voir la notule
L'Imposture Gluck.]
→ Malgré son hiératisme,
Antigona
tire aussi assez, dans les mélodies des récitatifs et dans l'harmonie,
vers le Mozart des Da Ponte (en particulier
Nozze et
Don Giovanni).
On y rencontre également de grands récitatifs accompagnés par des
accords d'orchestre. L'œuvre est vraiment intéressante, et la musique
en vraiment inspirée [davantage que les Gluck, à mon gré]. Assez proche
du style de la
Chimène de
Sacchini, sensiblement plus tardive (1783, après dix ans de
bouleversements musicaux).
,
Gli uccellatori (Kassel)
→ Gassmann est d'abord célèbre pour sa très amusante parodie, L'Opera seria,
écrite dans le style exact d'un genre qui était encore plein de
vitalité, mais dans l'envers du décor d'une troupe aux personnalités
dysfonctionnelles. D'une modernité librettistique étonnante, tout en
sonnant réellement comme ses modèles.
→ Les Oiseleurs sont une
autre œuvre comique (sur un livret de Goldoni!), elle aussi encore très
nettement baroque malgré sa date de naissance tardive (1729) ; mais
après tout, on n'est qu'en 1759 et à Venise !
Haydn, Orlando paladino (Munich, Hagen)
Haydn, Armida (an der Wien)
|
→ Le Haydn seria n'est pas
très mystérieux (ses opéras légers non plus), mais Armida
contient de beaux airs héroïques qui exploitent très bien le sujet
médiévalisant. On peut difficilement le considérer comme un progrès
après LULLY (déjà que celle de Gluck…), mais en tant que
seria classique, il a sa
réelle personnalité, et est agréable à écouter, à défaut de constituer
un drame intéressant.
Piccinni, Il regno della luna (Venise)
Piccinni, La Cecchina (Trévise)
|
→ Respectivement opera buffa
(c'est-à-dire une comédie) et dramma
giocoso (c'est-à-dire pas seria,
que ce soit comique ou d'un genre plus mêlé comme Don Giovanni),
deux œuvres où se manifeste une tout autre veine que celle du Piccinni
français, où domine vraiment la fluidité mélodique (non sans truculence
au besoin) – ce qui explique les divergences de composition pour le
répertoire français d'avec le modèle gluckiste. Pas fanatique de ce
confort sans angle très saillants, personnellement, mais c'est au
minimum tout un pan d'histoire !
Cimarosa,
Il matrimonio segreto (Théâtre
Musical des Enfants à Moscou, Saratov)
→ Là aussi, je diverge assez de
l'appréciation des contemporains. Pas d'imagination musicale très
hardie, cette jolie musique demeure tout le temps assez polie (quoique
d'une tournure personnelle), et tout cela dure fort longtemps pour une
intrigue aussi prévisible, même pour l'époque (secrètement mariée à
Paolo, la bourgeoise Carolina devrait épouser le Comte désigné par son
père, s'attirant la jalousie de sa sœur). Pourtant, succès
gigantesque à l'époque. J'aime beaucoup, mais l'époque a fourni
sensiblement mieux (à commencer par Cimarosa, témoin son irrésistible Maestro di cappella où la basse
bouffe appelle un à un les instrumentistes, les félicitant ou les
gourmandant).
Mozart,
La finta giardiniera (Milan,
Saint-Pétersbourg)
→ Un Mozart de prime jeunesse que je
trouve assez gentillet (et assez long pour son sujet), mais qui dispose
de quelques jolis airs. Bien en cour en ce moment, redonné sur un assez
grand nombre de scènes de premier plan.
Zingarelli,
Giulietta e Romeo
(an der Wien)
→ 1796, en pleine transition. L'orchestration, le langage demeurent
classique, mais les récitatifs secs sont très rossiniens, les duos
s'alanguissent en s'infléchissant progressivement de Mozart vers le belcanto romantique. Très
intéressant, sans être non plus trop profondément prégnant.
Le Teatro Donizetti
de Bergame (au pied des Alpes,
Nord-Est de Milan, entre Côme et Salò), où l'on donnera un opéra bouffe
de
Mayr, et un autre de Donizetti (évidemment), tous deux rarissimes.
4. Opéras romantiques
belcantistes
Cherubini,
Ali-Baba ou les Quarante Voleurs – en
français ou en italien ? (Milan)
→ Cherubini se situe à cheval sur toute
la série d'esthétiques franco-italiennes du temps : opéra sérieux sur
les livrets à la mode (Armida
abbadonata, Adriano in Siria,
L'Allessandro nell'India…),
opéras bouffes (Lo sporo di tre et
marito di nessuna, La finta
principessa), l'opéra-comique ambitieux (Les
deux journées), la
tragédie en musique (Démophoon),
l'opéra-ballet (Anacréon), les
commandes révolutionnaires (collaboration au Congrès des Rois), et tout un tas
de choses intermédiaires, comédies héroïques (Lodoïska), drames lyriques (Pygmalion), l'étrange Médée (tragédie en musique dans un
moule formel d'opéra-comique), avant de verser dans l'esthétique
romantique (Les Abencérages
en 1813), comme en témoigne tout à fait ce dernier opéras, créé à
l'Opéra de Paris, entièrement mis en musique (sans dialogues), dans une
veine très continue italienne un peu lisse. La seule version
discographique à ce jour, me semble-t-il, en est d'ailleurs une
traduction italienne, fort peu soucieuse du style musicale (très lent
et épais).
Mayr,
Che originali ! (Bergame)
→ Opéra-bouffe d'un des compositeurs
importants du temps, assez bien documenté au disque, rarement bien
servi
(versions très lentes et molles, pas mal de choses mal captées aussi).
Ce qu'on peut en percevoir n'est vraiment pas exaltant, une sorte de
Donizetti archaïque, aucune invention musicale ni même mélodique, du
sous-sous-Piccinni romantisé. J'avoue être passé tout à fait à côté –
sont succès doit bien avoir quelque cause. Mais je ne connais que ses
œuvres sérieuses, pas celle-ci.
Spontini,
Le Metamorfosi di Pasquale (Venise)
→ Je ne connais pas spécifiquement ses
opéras bouffes. Ses opéras-comiques contiennent très peu de musique (en
quantité), pas très marquants non plus, mais l'esthétique n'est pas la
même qu'en italien, il faut donc tenter.
Rossini, La Donna del Lago (Lausanne)
Rossini, Mosè in Egitto (Hanovre)
Rossini,
La Scala di Seta (Lausanne)
Rossini, La Gazza ladra (Saint-Pétersbourg)
Rossini, Il Viaggio a Reims (Hanovre)
Rossini, Il Turco in
Italia (Sydney)
|
→ Du Rossini sérieux (la fresque animée
sur Walter Scott de la Donna del Lago
est à mon sens le meilleur seria
de Rossini – et cette fois donnée par un « baroqueux » très animé,
Petrou), du Rossini léger, parfois anecdotique (la Pie voleuse est charmante, sans
atouts majeurs sorti de l'ouverture), parfois grisant (les typologies
endiablées du Voyage à Reims, assez
en vogue ces dernières années).
→ Quant au Turc, je le
distingue non pas en raison de sa suprême rareté – il est relativement
peu donné, et bien moins que son pendant L'Italienne,
mais donné tout de même –, mais parce qu'il constitue, à mon sens, un
sommet assez absolu du genre comique à l'opéra. Le livret
autoréférentiel de Felice Romani (le Poète est un membre majeur de
l'action), les ensembles endiablés, le sens mélodique, les récitatifs
éloquents, les personnages à la serpe mais touchants, la couleur
locale, et une douce nostalgie qui baigne parfois tout cela (le trio
final) quand ce n'est pas la franche rigolade (le trio de la bastonnade
du poète interventionniste)… tout concourt au succès final.
Inexplicable pour moi que ce soit le Barbier
qu'on joue autant, en comparaison. En somme, écoutez-le au disque, au
minimum (Conti chez Naxos ou Chailly chez Decca).
Donizetti, Poliuto (Barcelone)
Donizetti, Pia de' Tolomei (Pise, Lucques,
Livourne)
Donizetti, Maria di Rohan (Washington)
Donizetti, Pigmalione (Chicago)
Donizetti, Adelia (Hildesheim, Nienburg, Fulda)
Donizetti, Rita (Chicago)
Donizetti, Le convenienze ed inconvenienze teatrali
(Prague, Krasnoïarsk)
Donizetti, Il borgomastro di Saardam (Bergame)
|
→ Beaucoup de Donizetti bouffes peu
célèbres cette saison, et pas seulement en Italie. Je serais
mal placé pour faire la fine bouche sur cette part
de son legs, même s'il est très inégal (pour en rester aux deux plus
fameux, autant
L'Elisir me
paraît vertigineux, autant
Don
Pasquale
me semble très commun). De même, bien que j'aime assez prendre
Donizetti en mètre-étalon de la chicherie musicale du premier
romantisme italien, il existe de quoi se repaître dans son répertoire
sérieux, et
Poliuto, source
des
Martyrs, mérite un peu
d'attention. Moins convaincu par les
Gemma,
Pia,
Maria ou
Anna (voire tout de bon ennuyé),
mais pour ceux sensibles au genre, il y a de quoi varier de
Lucia en voyageant un peu.
Bellini, Il Pirata (Saint-Pétersbourg)
Bellini, La Straniera (Washington)
|
→ Enfant prodige du belcanto romantique, tôt emporté,
Bellini
rend la tâche assez facile pour faire le tour de sa production, pour la
plupart régulièrement donnée. Ces deux-là (et bien sûr l'Ernani inachevé mais très réussi)
illustrent assez bien ses deux facettes : le belcanto aimable un peu
fade (Sonnambula, Beatrice di Tenda, voire les Capuletti, déjà plus ambitieux)
pour Il Pirata
(très formel de surcroît) ; les raffinements discrets de l'harmonie et
de l'orchestration derrière le lyrisme, le sens dramatique aussi (comme
pour I Puritani) dans La Straniera, son meilleur opéra à
mon sens après Norma et Puritani.
L'Opéra National de Szeged (Sud de la Hongrie,
aux confins de la Serbie
et de la Roumanie). Son amphithéâtre… amphithéâtral est sur le même
modèle que celui de l'Opéra de Budapest. On y jouera Ernani de Verdi.
5. Révolution verdienne
Verdi, Oberto (Wrocław)
→ Son premier opéra, déjà
caractérisé par sa liberté structurelle, ses récitatifs remarquablement
mélodiques (et au cordeau prosodique), ses airs très dramatiques,ses
ensembles riches où chaque personne est individualisé. Une de ses
grandes œuvres, en réalité. Une fois Oberto
et Nabucco (son
troisième) composés, il faut attendre Stiffelio
(13 titres plus loin !) pour
Verdi, I Lombardi alla prima crociata (Turin)
→ Encore belcantiste, mais très
abouti, et la source (le sujet et une partie de la musique) de Jérusalem, sa première commande
française.
Verdi, Ernani (Monaco, Barcelone, Szeged,
Istanbul)
→ La censure autrichienne a un
peu défiguré (les Autrichiens n'appréciaient pas le roi dans l'armoire,
en particulier)
le livret, devenu assez inoffensif. La musique aussi, malgré ses
énormes qualités (les récitatifs sont des moments assez glorieux du
catalogue de Verdi), demeure encore pensée en « numéros », et
sensiblement marquée par le moule belcantiste (tout en étant déjà autre chose).
Verdi, I due Foscari (Bonn)
→ Réputé l'un de ses coups de
génie de jeunesse. Il y a là certes de belles choses, mais je n'y
trouve pas la prégnance mélodique ni la liberté de ses meilleures
œuvres des « années de galère ». Une très bonne œuvre néanmoins, qu'on
n'entend guère en France.
Verdi, Giovanna d'Arco (Konzerthaus de
Berlin, Rostov)
→ Du Verdi très belcantiste, pas
son meilleur ouvrage.
Verdi, Alzira à Buxton (Derbyshire)
→ Sa mauvaise réputation comme un
des Verdi les plus faibles me paraît exagérée (il vaut très largement Jeanne d'Arc et Legnano), sans constituer un sommet
non plus.
Verdi, I Masnadieri (Monaco, Bilbao, Rome,
en allemand Volksoper de Vienne)
→ De très beaux ensembles, des
airs moins passionnants.
Verdi, Il Corsaro (Valencia)
→ Un des meilleurs Verdi (de la
première période, en tout cas). Le sujet, emprunté à Byron (mais sans
humour, ici), propose un panache scénique remarquable, et bien que le
plan en demeure assez formel (avec des airs très identifiables), le
tout se suite comme une fresque aux jolies mélodies et à la tension
dramatique tout à fait réussie. Un charme très particulier, pour une
des œuvres les moins données de son auteur.
Verdi, La Battaglia di Legnano (Florence)
→ Probablement le Verdi que
j'aime le moins. Vraiment peu d'airs saillants, une forme très
scolaire… un dirait du (pas très grand) Donizetti écrit un peu plus
tard.
Verdi, Stiffelio (Budapest)
→ L'œuvre est totalement du niveau de la Trilogie
Populaire, encore plus aboutie que Luisa
Miller,
elle mérite clairement une entrée au répertoire. Les imprécations
désespérées du pasteur trahi par sa femme (oui, une femme adultère dans
un premier rôle féminin de grand soprano !), les ensembles
étourdissants, le brouillage récurrent entre récitatifs, « scènes »,
ariosos, airs et ensembles, tout concourt à l'admiration du traitement
d'un sujet déjà plutôt ébouriffant.
|
►
Verdi change tout. Vu à l'échelle de l'histoire musicale, il ne se
passe rien ici (
ou.
presque.), les Germains (et quelques français) ont
vraiment poussé les moyens de composition beaucoup plus loin.
À l'échelle de l'Italie, ou même de
l'histoire de l'opéra,
il en va tout autrement. Verdi fait passer l'opéra, qui baignait depuis
150 ans dans une fascination complaisante envers les voix agiles au
détriment des livrets et de la variété musicale, dans l'ère d'une
recherche d'impact dramatique, de couleur unique pour chaque ouvrage.
► Oh, certes, Verdi exalte
toujours les voix, et c'est ce qui fait son succès, il n'est pas
italien pour rien. Dans le même temps cependant, il impose à ses
librettistes un chemin qui fait de lui, aujourd'hui encore, l'un des
compositeurs d'opéra
les plus
efficaces de
tous les temps. Il peut, en une quarantaine de mesures, vous renverser
une situation, vous peindre cinq sentiments contradictoires, tout en
restant parfaitement clair. Il écrit des airs, oui, mais n'alanguit
jamais l'action, qui frappe comme la foudre.
► Par ailleurs, il est aussi (de
très loin), aussi étrange que cela puisse paraître,
le compositeur italien le plus avancé
dans le langage proprement musical, avant que n'arrive la nouvelle
génération menée Leoncavallo et Puccini : personne pour oser ces
modulations, ou même ses effets orchestraux (mesurés) ; pas non plus de
meilleur serviteur de la prosodie, et pourtant il est celui qui ose les
choses les plus hardies. Quand on explore le fonds de ses
contemporains, on est frappé par le fait qu'ils écrivent encore du
Donizetti enrichi, là où Verdi est vraiment, totalement,
incontestablement
ailleurs
(et au-dessus). S'il y a vraiment un domaine où le tri établi par
l'Histoire paraît inattaquable, c'est bien l'opéra italien du milieu du
XIXe siècle. Je veux bien discuter la suprématie absolue de Mozart
(je
n'ai pas dit que c'était évident : 1,2,3), pas celle de Verdi dans son domaine.
► À l'exception de
Stiffelio qu'on peut considérer
comme œuvre de maturité (juste avant
Rigoletto qui ouvre les années de gloire
incontestée, et juste après
Luisa
Miller qui en est peu ou prou), du fait de sa grande liberté,
ces œuvres rares susmentionnées sont toutes
de jeunesse (tout simplement parce qu'on joue abondamment toutes
celles qui suivent
Stiffelio,
sa refonte en
Aroldo
exceptée).
,
Don Checco (Naples)
→ Contemporain de Verdi, Nicola De
Giosa propose dans Don Checcho
un opéra bouffe qui évoque Rossini, voire Martín y Soler. Rare, mais
pas indispensable.
Foroni, Margherita (Wexford)
→ Cadet d'une douzaine d'années de
Verdi, Jacopo Foroni avait dû fuir l'Italie après avoir participé à la
révolte anti-autrichienne de 1848. Il dirige alors des opéras de
Bellini et Donizetti en Europe, et s'établit en Suède. Il y écrit ainsi
notamment
Christina, regina di Svezia
(« Christine de Suède »).
→ On sent chez Foroni l'impact de la révolution verdienne, avec un goût
pour les situations dramatiques et les ensembles, un soin de la
finition vraiment délectable. Le langage est certes un peu plus policé
et
rétro que celui de Verdi,
mais considérant son jeune âge (mort à 33 ans, il écrit
Margherita à 23 ans), il constitue
l'une des figures les plus prometteuses de l'opéra italien d'alors.
Voyez par exemple
ces extraits de Christina.
Encore une belle résurrection (avait-on rejoué
Margherita ? guère en tout cas) au
crédit de Wexford.

Comme vous n'irez probablement
pas cette année après le mal que vous lirez sur La Wally et Iris, contemplez ici la façade
typiquement italienne du Teatro
del Giglio (Théâtre du Lys) de Lucques,
un jour de marché.
6. L'après Verdi, l'après
Wagner
Catalani,
La Wally (Lucques, Wexford)
→ Emblématique à cause de son bel air
de Diva
aussi bien que par sa place emblématique dans le vérisme : on parle
souvent d'opéras véristes pour qualifier un style musical commun qui
s'adapte à des sujets tout à fait traditionnels en réalité (I Medici de Leoncavallo, Edipo de Mascagni, Andrea Chénier de Giordano… où est le naturalisme
là-dedans ?). Dans La Wally,
tout est vériste : l'intrigue présente les déviances de pauvres gens
(probablement consanguins) perdus dans la montage, leur vie mesquine et
déroire, leur mort ridicule.
→ Au demeurant, il n'est pas très étonnant que ce ne soit que peu donné
: ni le livret ni la musique (qui culmine en effet dans l'air) ne sont
vertigineux.
Puccini, Edgar (Saint-Gall)
→ Ce Puccini-là fait encore du Verdi,
et le fait diablement bien. Un Verdi plus souple et élégant, sans avoir
la même force dramatique ou mélodique, certes. Une très belleœuvre qui,
comme le bijou Le Villi,
mériterait abondante présence sur les scènes. Pour cette saison, il
faudrait voyager jusqu'au cœur de l'Helvétie pour pouvoœir en profiter.
Il y aura d'autres occasions.
Puccini,
La rondine (Gênes)
→ (C'est-à-dire « L'hirondelle », rien
à voir avec Schnitzler.) Supposément du Puccini plus conversationnel,
mais en réalité, c'est aussi l'une de ses œuvres les plus sirupeuses,
et sans la contrepartie d'un livret un peu méchant comme pour Tosca ou Turandot.
→ Intrigue de salon, un peu comme Fedora
de Giordano (dont la musique est moins complexe, mais aussi moins
dégoulinante). À noter, le rôle p'incipal (Ruggero Lastouc) fut créé
par Tito Schipa !
Giordano, Fedora (Stockholm, Saint-Pétersbourg)
→ Giordano, plus connu pour son Chénier, n'est pas réputé, et non
sans fondement, pour sa finesse ; néanmoins dans Fedora, même si la langue demeure
celle du lyrisme vériste, le dispositif du salon, à l'acte II
(requérant un pianiste virtuose qui doit jouer sur scène pendant que
les chanteurs conversent), est d'une originalité
et d'une réussite remarquables. C'est le dénouement qui est beaucoup
plus banal, et paraît assez éloigné de l'atmosphère d'intrigue des deux
premiers actes, plus nourrissants musicalement au demeurant.
Mascagni,
Iris (Lucques)
→ Réputé comme l'un des meilleurs
Mascagni, ce reste… du Mascagni. Certes, l'intrigue sort de l'ordinaire
: au Japon, une fille naïve enlevée par un séducteur, puis jetée dans
les lieux de perdition de la ville. Mais la musique demeure très
sommaire, purement italienne, l'orchestre bardé d'unissons inutiles,
comme toujours avec Mascagni – son Edipo aussi, roi grec tout de même,
s'exprime comme le Compare Alfio. On attendrait des couleurs
orientalisantes ou au minimum un climat plus voilé et tourmenté, rien
de tout cela – il nous refait même le coup de l'intermezzo de Cavalleria.
À l'intérieur de l'œuvre, les situations ne sont pas contrastées non
plus, impossible de distinguer la vie paisible de la jeune fille de
l'enlèvement, le village du lupanar… tout est écrit dans le même
lyrisme un peu droit.
Je n'aime pas beaucoup Madama
Butterfly,
autre sujet japonais au soprano expiatoire, mais c'est indéniablement
de la grande musique ; ici, tout est beaucoup moins clivant (moins de
sirop, clairement), mais aussi beaucoup moins intéressant.
Cilea,
L'Arlesiana (Deutsche Oper de
Berlin)
→ Par rapport à Adrienne Lecouvreur, L'Arlésienne représente
un moyen terme : ni les trépidations jubilatoires des archaïsmes du
début des actes I et III, ni les langueurs sirupeuses des grands airs
des héros… Une musique assez continue, fluidement italienne, pas d'un
grand relief, mais dont l'intrigue et le charme tiennent très bien en
haleine, surtout avec le renfort de la scène (et de bons chanteur).
Alfano,
Risurrezione (Wexford)
→ D'après Tolstoï, un titre très
post-puccinien, mais d'un Puccini un peu crépusculaire, vraiment
menaçant. Bel opéra, très différent des aspects plus modernes d'Alfano
(mais supérieur à son achèvement servile de
Turandot). Compositeur décidément
protéiforme, entre les influences françaises de la
musique de chambre, le décadentisme germanique des
symphonies, la bizarre conversation en musique chargée de
Cyrano…
Le Staatsoper Stuttgart (1912),
où se tiendra Le Prisonnier
de Dallapiccola.
7. Opéras des écoles du XXe
siècle
Casella,
La Favola d'Orfeo (Stanislavski de
Moscou)
→ Il ne faut pas en espérer le grand
Casella décadent : il s'agit d'une œuvre très néoclassique, et pas dans
le sens d'un langage épuré mais nouveau. Cet Orfeo
est plutôt comparable aux œuvres mineures de Milhaud, la simplicité
harmonique italienne et le sirop un peu visqueux en sus. Aussi éloigné
que possible de ses grandes œuvres symphoniques (même celles avec
voix). [La Donna serpente,
remontée l'an passé à Turin, ne vaut pas mieux : étranges imitations de
Boris et proximité avec Prokofiev, mais sans du tout, là encore, la
même matière musicale, particulièrement plate.]
Wolf-Ferrari, Il segreto di
Susanna (Turin)
→ Une délicieuse conversation en
musique aux accompagnements délicieusement boisés. Totalement tonal et
rafraîchissant, un très courte pièce (moins d'une demi-heure) au charme
archaïsant irrésistible.
Dallapiccola,
Il Prigioniero (Bruxelles,
Stuttgart, Florence, Dresde)
→ J'ai hésité à le mentionner, dans le Prisonnier est devenu un grand
standard des scènes ouest-européennes. Son sujet militant (tiré du Dernier jour d'un condamné
de V. Hugo) sur un domaine pas trop conflictuel (la torture
psychologique, c'est mal), son côté « humaniste », sa référence
littéraire, sa musique très sombre mais accessible (une tonalité
élargie mais tout à fait polarisée, complètement intelligible), son
climat oppressant, sa petite durée, tout en fait une excellente
passerelle pour les publics vers la musique du XXe siècle. [À titre
personnel, c'est plutôt Volo di notte
que je voudrais voir s'imposer, cette œuvre est d'une poésie
remarquable tout en clair-obscurs, et absolument de son temps tout en
empruntant un langage parfaitement familier.]
Maderna,
Satyricon (Salzbourg)
→ Grande masse de textes en patchwork
innombrables, pas forcément très musicale, mais assurément foisonnante
– j'avoue préférer les œuvres plus domestiquées de Maderna (le Concerto
pour hautbois, au hasard), mais l'expérience ne doit prendre son sel
qu'en vrai. (Plus encore que pour
Prometeo
de Nono, par exemple).
Rota,
Il cappello di paglia
di Firenze (Naples)
→ Autre bijou de conversation en
musique, peut-être pas très marquant musicalement, mais qui, joint au
texte, laisse planer le sourire sur les lèvres. De la belle comédie qui
suit de près la pièce de Labiche.
Au sein de l'immense répertoire du Mariinsky (Théâtre Marial, ancien
Kirov), on jouera cette bizarrerie d'opéra en latin d'un gamin de onze
ans.
8. Opéras en latin
Mozart,
Apollo et Hyacinthus K.38
(Saint-Pétersbourg, Helikon de Moscou)
→ Le premier opéra de Mozart (si on
compte Die Schuldigkeit comme
oratorio), composé à onze ans. Étrangement, seule la Russie semble le
donner cette saison.

Étages vertigineux de la salle
très scaligère du Teatro
Comunale Mario Del Monaco de Trévigny
(au Nord de Venise).
Pas si mal pour un répertoire encore plus défini que les autres par ses
têtes de gondole.
Restent encore beaucoup d'ères linguistiques à parcourir, à ce train-là
j'aurai fini de présenter la saison en décembre. Mais peu importe,
c'est aussi l'occasion de prendre conscience de ce qu'est le répertoire
des maisons du monde, concrètement, et il est assez différent de ce que
peuvent suggérer les disques.
Et puis si vous n'êtes pas content de la sélection ou du rythme de
publication, vous pouvez toujours
jouer pour passer le temps – l'exercice est
vraiment difficile
(13/15 en ce qui me concerne, et ce score
inclut des compositeurs que je n'ai, en toute honnêteté, pas encore
écoutés).