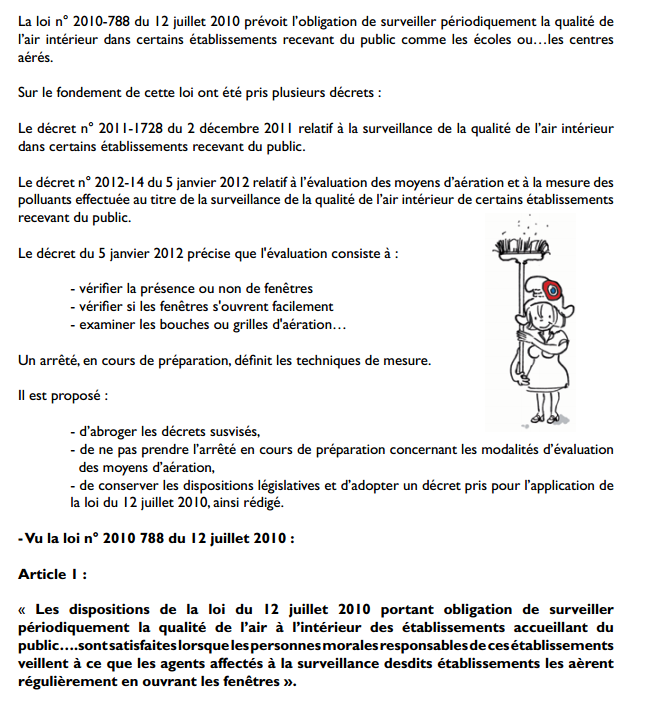jeudi 18 août 2016
Quand les mots empêchent de penser
Le nouvel earworm de l'été.
Tandis que le monde va comme il va, la France met ses voisins dans la bonne humeur en inaugurant une jolie polémique à caractère estival, parfaite pour meubler les JTs de l'été où il est bien sûr défendu de parler de ce qui se passe à plus de 50m d'une plage ou d'un bouchon. Et de manière plus générale de parler de choses importantes : les guerres et les tendances du monde ne peuvent pas s'exercer pendant le mois d'août, c'est bien connu. Après la tradition antique de la trêve hivernale, elles sont suspendues par le concept plus récent d'aveuglement estival.
Et quoi de mieux que de passer l'été à causer de tenues de plage, surtout si cela permet de faire semblant de parler politique (car on est des gens sérieux, tout de même). La corrélation entre attentats (par des fumeurs de spliff et buveurs d'alcool) et tenue religieuse constitue déjà un biais assez surprenant, et plutôt déplaisant – les mêmes qui recommandent en façade de ne pas faire d'amalgame proposent le meilleur raccourci entre une pratique religieuse active et ostensible (dont on peut au demeurant discuter les préceptes autant qu'on veut) et la destruction de la société au nitrate d'ammonium.
Mais que les hommes politiques soient de mauvaise foi et les journalistes complaisants en y donnant un écho superflu pour vendre du papier, il n'y a pas là grande nouveauté.
En revanche, ce qui n'est pas une nouveauté non plus, mais entre davantage dans les attributions habituelles de CSS, c'est l'usage des mots. Le vocable burkini est repris par tous, et guère interrogé. Or :
¶ Le mot est un néologisme très adroit (quelle juxtaposition !), mais il ne reflète pas du tout la réalité du vêtement. Il s'agit d'une combinaison de plongée avec un foulard un peu bouffant, des manches un peu amples ; dans la rue, ça ressemblerait à une chemise et un vêtement amples pour femme, avec un foulard par-dessus. Alors que la référence à la burqa suggère qu'il s'agit de cacher l'entièreté de la femme (et, fait déterminant, son identité en supprimant le visage), on a simplement affaire à un vêtement à manches longues.
¶ Qu'il soit conçu, acheté et porté en revendication religieuse, très certainement, et là encore, il peut y avoir matière à débat (en France, la liberté d'expression religieuse dans l'espace public, garantie par la loi de 1905, est de plus en contestée pour pousser la pratique vers l'espace privé). C'est néanmoins, en l'état actuel, parfaitement légal – cette tenue, dans la rue, sorte de chādar moulant (voire de simple association chemise ample / pantalon léger ou moulant), ne ferait même pas tourner la tête. Elle devient choquante manifestement par contraste avec ce que l'on attend d'une tenue de plage (il doit assurément faire chaud là-dessous, a fortiori avec les couleurs souvent sombres !), et d'une certaine façon indécente à l'envers, puisque éloignée de la norme. [Et indécent jusqu'à ce qu'on lui attribue de causer des violences, qui n'auraient jamais eu lieu si l'on avait pris des photos de gens dénudés plutôt qu'habillés ?]
¶ Le plus gênant, c'est que le mot est repris en chœur par tous ceux qui commentent la chose, pour ou contre, sans la moindre explicitation ou mise à distance. Ce qui suppose, si l'on est pour, l'affirmation de la nécessité d'occulter les femmes (des filles, pouah), et si l'on est contre, une infraction à la loi sur le voile intégral (et donc, qu'on a pour soi Dieu et mon droit).
¶ Pour couronner le tout, on peut lire des articles entiers, écouter des émissions d'une heure, sans que l'origine du négologisme soit jamais indiquée. Ce qui est important, tout de même, considérant le biais qu'il induit, suggérant non pas une légitime pudeur, mais l'occultation complète de la femme dans l'espace public.
D'après ce que j'ai pu trouver, le mot n'est à l'origine ni le fruit d'une prescription religieuse, ni l'effet d'une description hostile : il s'agit tout simplement d'un nom de marque déposé en 2006 par une styliste australienne d'origine libanaise (« burkini » et « burqini »), donc d'un nom délibérément marquant (et même légèrement catchy), qui ne cherchait pas la précision du concept mais plutôt la facilité de l'appropriation. Elle avait d'ailleurs commencé en proposant le hijood (soit « sweat à foulard »), autre très joli néologisme tout aussi imprécis – c'est un hoodie sans hood, précisément…
Il y a donc bien un projet religieux dans la tenue, mais on ne réprouverait pas la même chose dans la rue ou porté par quelqu'un qui ne voudrait pas montrer son corps pour des motivations évangélistes ou personnelles, ce qui revient à remettre l'équité entre les fragiles mains de l'interprétation des symboles. Non pas pour ce qui est fait, donc, mais pour ce que cela pourrait éventuellement signifier.
Si l'on passe le sujet totalement futile — a-t-on le droit de laisser les femmes bronzer ou se baigner trop couvertes, sérieusement, les épidémies se succèdent en Afrique de l'Ouest, les régimes stables du Proche-Orient menacent d'imploser, le patrimoine mondial est systématiquement détruit par des illuminés, nos alliés bombardent des hôpitaux, les enfants meurent dans les fabriques de tissu bangladaises, la Corée du Nord fourbit ses ogives, il n'y a plus de saisons… et c'est l'urgence du moment ? —, c'est un débat assez passionnant. Quelle est la place de la norme dans une société (et spécifiquement une démocratie, donc garantissant les droits individuels tout en obéissant aux tendances de l'opinion majoritaire), quelle coercition exercer sur le libre arbitre, quel est aussi le contour du consentement (comment prouver que ces femmes qui se disent volontaires ne le seraient pas ?), quelle place donner au symbole dans l'exercice des libertés (se couvrir serait permis, sauf motivation religieuse à établir ?)…
Je n'ai pas forcément de réponse à tout ça – et plutôt partisan de laisser les gens tranquilles en ne s'embrouillant pas dans une série de coercitions contradictoires –, mais il serait tellement plus facile de s'en occuper, même sans retirer la mauvaise foi, si l'on utilisait simplement des termes exacts et dépourvus de trop grands biais.
À part ça, c'est un joli nom de marque, félicitations.
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Vaste monde et gentils a suscité :
11 roulades :: sans ricochet :: 1501 indiscrets