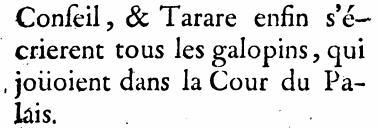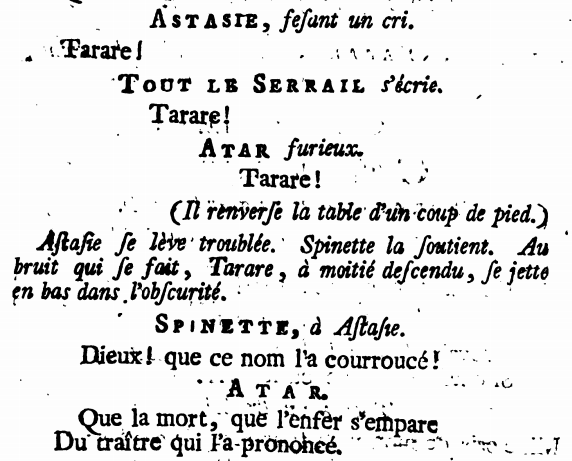Le divin Mozart
¶
Le
Nozze di Figaro par
Nézet-Séguin
et l'
Orchestre de Chambre d'Europe.
Le
Don Giovanni était très
bon, le
Così fan tutte
absolument parfait (dans la veine allègre plus que philosophisante).
Ces
Noces sont
aussi une grande réussite, où prévaut l'accompagnement hors du commun
du COE : on pourrait se contenter d'écouter l'orchestre, qui chante en
permanence, où tous les plans sont audibles et en palpitation
constante, avec une variété de couleurs hors du commun.
Le résultat global est remarquable, mais fait moins autorité, surtout
considérant l'aléa vocal : tous les chanteurs sont bons (à commencer
par le Figaro de Pisaroni, à l'italien exact et savoureux), mais si
Hampson n'a pas dû être très précisément bridé sur l'accent (moins bon
qu'à l'accoutumée) et Yoncheva, très crédible (et différenciée) dans
cet entre-deux-âges décrit par le texte (incroyable comme elle a
véritablement une voix
d'après-grossesse,
à la fois jeune et mature), me gêne assez du côté de la diction
relâchée et des voyelles pas du tout idiomatique. Une très bonne
référence qui se place parmi les meilleures (la palme restant au DVD
Pappano / McVicar).
Le
génial Czerny
Je découvre
l'enregistrement de deux
quatuors
supplémentaires de Czerny (
Sheridan
Ensemble,
chez Capriccio), en la mineur et ré majeur s'ajoutant aux ré mineur et
mi mineur (qu'ils ont aussi enregistrés) déjà gravés par le
St Lawrence String Quartet.
L'ensemble du corpus est d'un niveau exceptionnel : beaucoup de traits
communs, y compris dans les procédés et la qualité du résultat, avec
les derniers Schubert. J'y reviens très souvent, avec toujours plus
d'émerveillement – qu'est-ce que ce serait, si l'on disposait de la
même générosité discographique ! – mais le nom de Czerny, toujours
associé à ses œuvres pédagogiques, semble durablement terni auprès du
grand public.
En plus de l'aspect général assez schubertien, il y a aussi une gestion
ambitieuse de la forme qui ne repose pas sur la mélodie et la
répétition de schémas stables : beaucoup de parentés avec le corpus de
Beethoven aussi – et honnêtement, pas un Beethoven fade ou raté.
De véritables zones d'ombres injustifiables dans le répertoire de
quatuor. (Ceux de Bruch sont très bien aussi, mais on y sent un niveau
légèrement inférieur à ces modèles, ce qui n'est pas du tout le cas de
Czerny à mon sens.)
Pareil pour sa
Première Symphonie,
au demeurant : quelque part entre l'énergie des motifs de Beethoven et
la poésie des timbres de Mendelssohn, vraiment une œuvre importante (et
à titre personnel, peut-être la
symphonie
qui m'est la plus chère). Étrangement, les autres symphonies publiées
au disque (2 deux fois, 4, 6) ne sont pas très passionnantes.
En plus, l'interprétation de
Nikos
Athinäos et tout à fait ébourissante, sur le splendide orchestre
de
Frankfurt (Oder) qui
semble pour cette fois jouer sur des bois et cuivres d'époque.
La Force du Destin
Découverte de
quelques nouvelles versions, très marquantes, de
La Forza del Destino de Verdi,
tellement mieux servie sur le vif.
J'ai déjà dû mentionner, en carnets d'écoutes, mes deux versions de
chevet :
♣ Solti à Covent Garden (1962),
paru chez Myto (et pas réédité, apparemment – mais c'est désormais du
domaine public) : Floriana Cavalli y chante assez faux, mais déclame
comme personne. Bergonzi, dans ces années, dispose, en plus de la grâce
du timbre, de toute l'ardeur requise (perdue dans le studio de
Gardelli, où il paraît assez bonhomme pour un mulâtre maudit, fils
d'empereur provoquant en duel les Grands d'Espagne…). Veasey,
(John) Shaw, Capecchi, Ghiaurov, et même (Forbes) Robinson (Marquis de
Calatrava extrêmement prégnant, dans un très bel italien d'ailleurs)
tous marquants, et surtout cette énergie d'équipe. Solti y est direct,
sobre, toujours animé, à l'opposé des studios rutilants et assez figés
de la même période. Vraiment idéal en tout point. [écoutable
ici]
♣ Schmidt-Isserstedt à
Hambourg (1952) en allemand
(chez Walhall), avec Clara Martinis (timbre cousin de Mödl, avec plus
de souplesse), Mödl, Metternich, la fine fleur du chant allemand de ces
années est là, et l'ensemble brûle les planches, le relief de la
prosodie allemande en sus. Rudolf Schock est comme toujours assez peu
enthousiasmant, mais dans ce contexte, il semble aussi gagné par la
fièvre générale. [écoutable
ici]
J'aime bien sûr beaucoup le
studio
Molinari-Pradelli (Tebaldi, Simionato, Del Monaco, Bastianini,
Siepi),
Mitropoulos à Naples en 53
(Tebaldi, Corelli, Bastianini, Christoff),
Votto en 57 avec Gencer et Di
Stefano, ou bien les différents
Muti
(le studio avec Freni, Domingo, Zancanaro, avant tout pour l'élan
orchestral ; bien sûr la plus récente bande avec Cura et Nucci,
électrisante), mais l'électricité n'y atteint pas ces sommets. Dans la
discographie totalement pléthorique (l'intrigue est complètement
invraisemblable et très bizarrement éclatée, mais quelle collection de
morceaux de bravoure pour mettre en valeur les plus belles voix, et par
conséquent très enregistré, avec une plus-value plus forte de
l'accumulation que pour bien des œuvres plus abouties !), je viens de
découvrir deux petits bijoux moins courus.
♣ Nino Sanzogno à l'Opéra de Rome
en 1957
(Myto) : une version pas particulièrement dramatique – l'orchestre,
comme on pouvait s'y attendre avec ce chef, peut paraître vaguement
indifférent –, très belle vocalement. Anita Cerquetti à son sommet, qui
n'articule pas forcément très précisément le texte, mais le coule dans
une
morbidezza (un moelleux)
superbe, voisine avec Boris Christoff dont l'articulation vocale semble
étonnamment italienne, et Aldo Protti qui n'a jamais été aussi
séduisant (pas exactement sa qualité première d'ordinaire). Même si
Pier Miranda Ferraro ne paraît pas très concerné par les tourments du
pauvre Alvaro, la voix est belle, et le duo d'adieu avec Protti est une
petite merveille de fusion. Ici encore, Renato Capecchi irrésistible et
un Calatrava charismatique (Antonio Massaria). Pas une version ultime,
mais pour ce qui est de la réjouissance glottique, on fait
difficilement mieux. [écoutable
ici]
♣ Le grand choc a été la découverte de la version d'
Ottavio Ziino à Florence en 1961
(chez Living Stage). Beaucoup plus engagé orchestralement (sans être
joli), et une distribution survoltée (à telle enseigne que Cossotto se
vautre méchamment dans son texte… sauvée par le
suggeritore),
jusqu'au jeune Cappuccilli (c'est
lui qu'on vend sur la pochette), beaucoup moins impavide que dans la
plupart des soirées de sa carrière – par ailleurs, on croit entendre un
vernis timbral plus agréable que l'armature un peu grise qui est
d'habitude sa marque (inaltérable, mais pas forcément
beau).
À cela, on peut ajouter que le rôle flatte son tempérament hiératique.
Le reste du plateau est constitué de chanteurs peu célèbres ou
modérément cotés, et pourtant tous superlatifs ce soir-là : Silvio
Maionica, encore un grand Calatrava, moelleux, simple et éloquent ;
Guido Mazzini, Melitone complètement ténorisant, mais remarquablement
utilisé dans une composition réellement malveillante, rare et très
convaincante ; Ivo Vinco, réputé court de voix et d'esprit, qui impose
ici une majesté que je ne lui connaissais pas ; Flaviano Labò, avec son
émission de type dramatique, inhabituelle, et toujours très engagé ;
enfin, le sommet de tous les sommets, Marcella De Osma, dont la
postérité n'a à peu près rien retenu, alors que son grain et sa
déclamation sont hors du commun – il faut se figurer Tebaldi, son
mordant et sa diction, mais qui aurait du molleux, un aigu facile et un
véritable engagement dramatique ! Et l'ensemble s'enchaîne avec
naturel, sans paraître une suite de numéros de bravoure clos, avec de
véritables dialogues entre les personnages. Très grande version.
[écoutable
ici]
Toutes ces bandes (sauf Muti, bien sûr) sont désormais
libres
de droit,
donc librement téléchargeables sur les sites pirates sans enfreindre la
législation (sauf si vous utilisez une technologie P2P, bannie par la
loi française quel qu'en soit le contenu).
L'horrible Richard Wagner
¶
Tristan,
acte III,
Maazel à l'Opéra de Munich
(Behrens, Murray, West, Titus, Salminen, Volker Vogel, Haefliger,
Rensburg). Le Prélude le plus impressionnant qu'on puisse entendre : ce
début gras, rauque, pesant du désespoir, qui s'étiole progressivement
vers l'impalpable de la mort, très marquant. Vocalement, c'est une
fête, la facilité de
Behrens,
la rondeur de
West,
assez peu fêté des wagnériens alors qu'il prolonge la bénédiction de
Jerusalem,
Titus et
Salminen dans leurs grandes
années, et les petits rôles les mieux tenus de tout le patrimoine.
La tension baisse un peu à la fin de l'acte (en tout cas par rapport
aux deux premiers beaucoup plus continûment intenses), mais il est rare
d'entendre un
Tristan à la
fois si bien chanté et si constamment tenu et tendu. J'avais récupéré
la bande en ligne (avec la mise en scène inoffensive de
Hans Schavernoch), ça se trouve
peut-être encore sur YouTube et ça mérite le coup d'oreille.
¶
Das Rheingold
dans mes versions de chevet :
Keilberth
52 (avec Witte et Uhde),
Kempe
Bayreuth (avec Stolze et Uhde !),
Karajan studio (avec Stolze et
Fischer-Dieskau),
Solti Bayreuth
(avec Jung et Nimsgern),
Gergiev
studio (avec Rügamer et Pape),
Weigle
Frankfurt (avec Streit et Stensvold). Chacun avec des vertus
dissemblables, mais tous verbe très haut. Redécouvert aussi
Böhm 66
(avec Windgassen et Adam), dont la crâne franchise, malgré les timbres
orchestraux disgracieux, a quelque chose d'assez électrisant.
¶
Die Walküre,
acte III,
Mark Elder et le
Hallé Orchestra, chez le label de
l'orchestre. Prise de son ample et détaillée, assez extraordinaire, ce
qui nous vaut un
Crépuscule parmi
les plus palpitants du disque, pas forcément à cause de la posture du
chef ou de la qualité des chanteurs (quoique tous très bons) que parce
que les équilibres sonores sont idéaux pour profiter de tous les petits
événements qui parcourent une partition wagnérienne.
Dans la
Walkyrie, c'est moins
capital et moins convaincant : on y entend beaucoup, tout de même, les
limites individuelles des chanteurs ;
Yvonne Howard, très bien par
ailleurs malgré un allemand un peu blanc et lisse,
pousse pas très joliment dans son
action de grâce ;
Susan Bullock,
un excellent choix pour les deux dernières journées, paraît un peu
large et rugueuse pour cette « jeune » Brünnhilde-là ;
Egils Siliņš n'est,
conformément à sa réputation, pas très frémissant… Les deux premiers
actes, écoutés il y a quelques (dizaines de) mois, sont meilleurs que
celui-ci, très beau plastiquement mais guère tendu, et pas toujours
raffiné non plus.
Dans la collection, en revanche, ne manquez pas la Troisième de
Sibelius (et le
Crépuscule,
donc).
¶
Siegfried,
actes I et II, tiré du cycle de
Sebastian Weigle avec l'
Orchestre
de l'Opéra et du Musée de Francfort, publié chez Oehms. L'un des
derniers
Ring parus au
disque, et l'un des plus aboutis aussi. Orchestralement, il confirme
que le
Musée de Francfort est possiblement le meilleur
orchestre d'Allemagne : impossible de trouver plus virtuose et
discipliné, épousant les choix subtils de Weigle avec un supplément de
chatoyance très bienvenu.
Rheingold est
(à ses demoiselles du Rhin près) une référence absolue, et on mesure
facilement ce que
Siegfried
peut gagner d'une lecture orchestale souple, expressive, raffinée et
généreuse.
Hélas, vocalement, l'exaltation est (beaucoup) plus mesurée (alors
qu'avec des chanteurs à peine meilleurs, on aurait pu parler de
référence à peu près absolue pour ce cycle) :
Peter Marsh (Mime) et plus
encore
Lance Ryan
(Siegfried), dans la mauvaise pente de leurs carrières, sont
particulièrement disgracieux (et c'est un admirateur de Manfred Jung
qui parle),
Jochen
Schmeckenbecher (Alberich) plus terne que dans l'
Or du Rhin.
Sterje Stensvold, toujours
élégant (qualité rarissime dans ce répertoire) est dans une position
qui flatte un peu moins ses qualités (la puissance étant limitée), mais
demeure une valeur très sûre, sa belle patine rendant bien compte
du temps qui a passé. (Et dans le III, que je n'ai pas réécouté,
Susan Bullock est tout à fait
à son affaire.) Mais un
Siegfried
où Siegfried et Mime piaillent sans trêve finit par agacer l'auditeur
de bonne volonté, alors même que ce qui se passe à l'orchestre est
passionnant.
¶
Siegfried
en entier, par
Karajan à
Bayreuth à la réouverture de
1951 (certaines bandes ont été
réputées perdues puis retrouvées, je n'ai pas tout suivi, mais il nous
reste au moins un
Or
remarquable avec Karajan-S.Björling et le
Crépuscule, limité par sa prise de
son étroite, avec Knappertsbusch-Varnay-Aldenhoff-L.Weber).
Très impressionnant : l'orchestre claque, fuse, file et frémit comme
dans le Tristan de 1952, mais avec une précision qu'on ne croyait pas
possible à cette date à Bayreuth ; vocalement, certes, le réveil de
Varnay est un peu violent,
mais
Aldenhoff, le
prince des princes, croisant le verbe haut de
Paul Kuen (Mime) et la haute
stature de
Sigurd Björling
(Wanderer), c'est un peu le rêve absolu. Il reste que le niveau de
détail orchestral est nécessairement limité par la prise de son, mais
Walhall a comme d'habitude fait un très bon travail qui rend l'écoute
de la bande parfaitement confortable.
¶ Une erreur de jugement, réécouter
Der Götterdämmerung
par
Knappertsbusch (en
1951).
La distribution est tellement irrésistible : Varnay, certains, mais
ensuite Mödl, Höngen, Aldenhoff, Uhde, soit individuellement les
meilleurs titulaires de chacun de ces rôles, et puis Ludwig Weber en
Hagen, et Schwarzkopf & Töpper en Filles du Rhin ! Mais
alors, joué aussi globalement, sans réelle articulation, en gros blocs
indolents (et approximatifs), on s'ennuie assez vite, indépendamment
même des
propriétés de l'ouvrage.
Monographie
Marie Jaëll
(Bru Zane)

Je
n'avais jusqu'ici eu accès qu'au piano, de très bonne facture, mais pas
forcément profondément marquant. Impression démentie par les cycles
Ce qu'on
entend dans l'Enfer / le Purgatoire / le Paradis (en
extraits seulement dans le coffret) et surtout
Les jours pluvieux,
où souffle déjà le vent des nouveautés, les recherches harmoniques et
climatiques de Dupont, Hahn et des autres auteurs de grands
cycl
es
français.
Les deux
Concertos pour piano sont
très réussis, dans un style tout à fait post-chopinien qui ne se limite
pas à l'épigonisme, mais prolonge en quelque sorte le plaisir dans une
période qu'on sent plus tardive.
Enfin,
La Légende des Ours,
assez longue cantate (cycle de mélodies orchestrales ?) de 25 minutes
pour soprano et orchestre, est sans doute ce qui présente le plus un
style propre, d'un romantisme très habité, dramatique mais coulant avec
naturel, mi-poème symphonique, mi-mélodie. Un plaisir d'entendre
Chantal Santon-Jeffery en forme (ce qui n'est plus guère le cas dans le
répertoire baroque français où elle officie beaucoup) et Hervé Niquet
cingler le Brussels Philharmonic, tous à leur meilleur.
Pas une découverte capitale, de même que les dernières parutions de Bru
Zane, mais de très belles découvertes pour qui s'intéresse aux recoins
inexplorés de la période, ce qui semble de plus en plus être
l'orientaton scientifique du Palazzetto : montrer l'état de la création
au XIXe siècle, plutôt que d'y chercher les chefs-d'œuvre les plus
personnels et insolites.
… et deux expos, au Louvre.

► Celle sur le
Musée
des Monuments
Français d'
Alexandre Lenoir
est très réussie. Elle tire avantage de la nette partition des deux
espaces d'exposition : la première partie reconstitue la motivation
historique (sauvetage à la Révolution des œuvres sur le point d'être
saccagées) et la disposition topographique du musée disparu (les salles
étaient organisées comme des initiations didactiques par siècle) ; la
seconde explore les influences et l'idéologie stylistique de la
démarche, culminant avec la reconstitution des monuments composites
qu'il avait érigés.
L'intérêt, plus encore que les œuvres exposées, réside dans la mise en
valeur du dispositif et de la pensée de son créateur : sauver le
patrimoine (parisien, puis au delà) de la destruction, sous la
Révolution. Avec un tout à la fois souci de l'édification du public
très réussi (chronologie), une mise en valeur marquante (ces amas
d'œuvres théâtralisées devaient avoir un impact dramatique assez
spectaculaire) et un sens de l'authenticité qui n'est pas le nôtre
(Lenoir recréant des objets fonctionnels complets à partir d'éléments
disparates, au besoin dédiés à des personnages historiques auxquels il
n'étaient nullement destinés, comme Jeanne d'Arc…).
On peut aussi suivre l'histoire de ce musée éphémère : situé aux Petits
Augustins, constitué des saisies mais aussi des achats par Lenoir
(revendant les pièces moins intéressantes aux marbriers pour pouvoir
acquérir d'autres œuvres), il est progressivement dépouillé de ses
collections sous le Consulat (les Antiques vont au Louvre et ne restent
que les moulages, Joséphine s'approprie des statues, le Concordat de
1802 rend les figures sacrées).
Mais le plus intéressant du projet est peut-être de souligner la
puissance et la rémanence de ces quelques salles sur l'imaginaire du
XIXe siècle : lorsque Charles-Marie Bouton peint la folie de Charles VI
en 1817, il représente la scène dans la salle XIVe du musée.

► La première exposition à la
Petite
Galerie – en réalité quelques pièces à la base de l'aile
Richelieu aménagées en espace d'exposition, je suppose que ce nom est
issu du jeu de mots d'un conservateur entre la Grande Galerie qui
reliait le Louvre aux Tuileries et l'âge du public visé –, «
Mythes fondateurs ».
Le principe est de sensibiliser les plus jeunes, mais je vois beaucoup
de biais gênants.
╩
Le contenu se limite à peu près à la mythologie grecque et
à la science-fiction – c'est un peu
court pour évoquer la spécificité d'un mythe, d'autant que les
comics ou le
space opera ne sont appelés mythes
que par extension.
╩
Les objets sont mélangés sans distinction d'époques et de cultures
d'origine – je me figure les orgasmes violents du directeur de la
communication patrimoniale, avec la supra-transversalité des cultures,
mêlant une tablette cunéiforme, une hache rituelle d'art premier, une
statuette égyptienne et une monnaie grecque dans la même vitrine.
Néanmoins, il est justement intéressant pour le jeune public, à mon
sens, de montrer que
tout le monde n'utilise pas les mêmes moyens, selon les lieux et les
époques, pour représenter la même idée.
╩
Pourquoi pas un parcours thématique, au demeurant, mais les cartels
sont tellement pauvres qu'ils n'offrent pas beaucoup de munitions aux
accompagnateurs de bonne volonté pour satisfaire la curiosité du jeune
public. Un résumé de la personnalité décrite par l'objet, mais rien sur
l'origine, la matière, le point de vue… comme si tout était pareil et
interchangeable. J'ai trouvé ce bric-à-brac plutôt désagréable, en
réalité.
Heureusement, il y avait la véritable pièce de collection, le heaume de
Lord Vader, prêté par le musée de George Lucas – et un peu le principal
argument de vente. C'est émouvant, d'une certaine façon, parce que
j'étais persuadé qu'il dormait quelque part dans un coffre(-fort) ;
sinon,
c'est gros, ça a l'air lourd, et ça ressemble énormément à ce qu'on
voit dans le film.
Évidemment, aucun parallèle n'est tracé entre ces différents mythes,
aucune distinction non plus. Une installation contemporaine dans une
pièce à part, figurant le rayonnement du soleil, et… ?
L'art
incarné
Pour finir, une installation urbaine rencontrée hier : maître
inconséquent mais passant pourvu du sens de l'humour.












 ► Celle sur le
► Celle sur le 
 ► La première exposition à la
► La première exposition à la 

 Il
m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,
cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu
mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de
l'opéra de Beaumarchais.
Il
m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,
cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu
mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de
l'opéra de Beaumarchais.