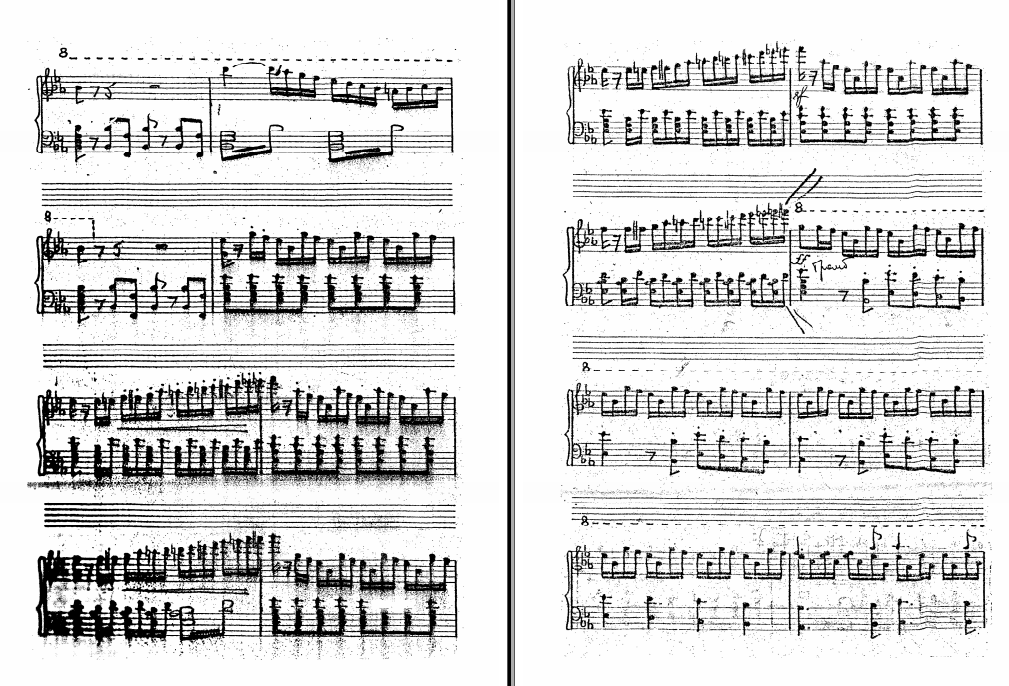(Oui, parfaitement, je suis très fier de mon titre.)
"Well—as thou wilt—ascetic as thou art—
"One question answer; then in peace depart.
"How many?—Ha! it cannot sure be day?740
"What star—what sun is bursting on the bay?
"It shines a lake of fire!—away—away!
"Ho! treachery! my guards! my scimitar!
"The galleys feed the flames—and I afar!
"Accursed Dervise!—these thy tidings—thou
"Some villain spy—seize—cleave him—slay him now!"
Up rose the Dervise with that burst of light,
Nor less his change of form appall'd the sight:
Up rose that Dervise—not in saintly garb,
But like a warrior bounding from his barb,750
Dash'd his high cap, and tore his robe away—
Shone his mail'd breast, and flash'd his sabre's ray!
His close but glittering casque, and sable plume,
More glittering eye, and black brow's sabler gloom,
Glared on the Moslems' eyes some Afrit Sprite,
Whose demon death-blow left no hope for fight.
The wild
confusion, and the swarthy glow
Of flames on high, and torches from below;
The shriek of terror, and the mingling yell—
For swords began to clash, and shouts to swell—760
Flung o'er that spot of earth the air of hell!
G.G. Byron, The Corsair II,4
« Fort bien, sois ascétique, ainsi que tu te plais
À l’être ; un mot encore, et te retire en paix,
Combien ? — Ah sûrement, non, ce n’est pas l’aurore,
Quel astre, quel soleil au golfe vient d’éclore ?
C’est comme un lac de feu ? Gardes, je suis trahi,
Aux armes ! Accourez : mon cimeterre ici !
Ah ! Derviche maudit, ce fut là ta nouvelle.
Allons, saisissez-le. Fendez-le par moitié,
Ô perfide espion ! tuez-le sans pitié ! »
Le Derviche se dresse à ce jet de lumière,
Son changement de forme a saisi tous les yeux.
Il dépouille l’habit du sacré ministère,
Debout comme un guerrier sur son coursier fougueux,
Il jette fièrement son bonnet de Derviche
Et déchire en morceaux une robe postiche ;
De maille on voit sa cotte et son sabre briller,
Sous un panache noir un casque étinceler.
Sous un sombre sourcil on a vu surtout luire
Son œil sur l’œil du Turc. C’est celui du vampire,
Fatal démon de mort, dont le sinistre éclat
Menace de coups sûrs, sans offrir le combat.
Le désordre confus, et la lueur blafarde
Des feux d’en haut, plus bas de la torche qui darde
Ses flots rouges et noirs, de la terreur les cris,
Des fers s’entre-choquant le perçant cliquetis ;
Les imprécations dont retentit la salle,
Tout a fait de ces lieux une scène infernale.
Tiré de la belle traduction en vers de Regnault. Un épisode où
prédomine l'action trépidante (comme à certains endroits du ballet,
avec bien moins de surprises et d'éclat) sur l'introspection aux deux
extrémités du poème.
Assisté à la première représentation de la série du
Corsaire chorégraphié par
Anna-Marie Holmes d'après
Petipa puis
Sergueïev/
Sergeyev,
régulièrement donné en tournée par la troupe de l'English National
Ballet. Le livret, adaptation par la chorégraphe de l'adaptation de
Saint-Georges (Jules-Henri) et
Mazilier,
fournit une large portion, par rapport à la norme du genre, en
péripéties, décors et pas d'action. La musique est à l'origine d'
Adolphe Adam,
et sans être du niveau de ses meilleures œuvres, permet d'entendre des
choses plus plaisantes que les redoutables ballets de Minkus ou des
adaptateurs fous.
[La musique du ballet original de
1856,
plus les ajouts de Delibes, ont été documentés par Richard Bonynge et
l'English Chamber Orchestra,
écoutable
ici.]
À l'issue de la soirée, beaucoup de questions se pressent : quoique
déjà familier de ce ballet-ci, je suis plutôt un candide en matière de
danse, et vais donc remplir mon office en posant quelques questions qui
ne doivent pas manquer d'assaillir les amateurs de musique.
Tamara Rojo en Médora, à l'acte
II.
(Le costume kitschouille reste largement plus élégant que le
tutu rose flamboyant de la version russe en usage…)
1.
Aller au ballet pour la distribution
Rien que la hiérarchie de la notule trahira ma simplicité : je commence
par ce qui, pour tout balletomane, doit constituer l'essentiel.
Outre la musique (sur laquelle j'aurai l'occasion de m'étendre plus à
loisir), les ballets du premier romantisme étant finalement peu
nombreux sur les scènes, je me suis particulièrement déplacé pour
voir danser Tamara Rojo, ancienne
étoile du Royal Ballet (celui de l'Opéra, à Covent Garden) et actuelle
directrice artistique de l'
English
National Ballet qui donnait ce
Corsaire.
L'English National Ballet est l'une des principales compagnies du
Royaume-Uni, et la seconde d'Angleterre en termes de prestige, une
grande maison. Son statut historique n'est pas le même que celui du
Royal Ballet : l'
ENB est fondé
en 1950 par d'anciens danseurs des Ballets Russes de Diaghilev, et
descend donc d'une autre tradition. À l'heure actuelle, en matière de
répertoire comme de style, la distinction n'est plus guère sensible :
on y voit d'abord les grands ballets du répertoire, les mêmes
qu'ailleurs – et vu que ses danseurs émanent des mêmes écoles que ceux
du Royal Ballet, la manière n'est pas russe non plus.
Pourquoi
Tamara Rojo ?
Je
l'ai dit, je suis assez peu versé dans le ballet (du moins dans sa
dimension visuelle), or Tamara Rojo est l'une des très rares
interprètes à m'avoir paru, au delà des gestes techniques omniprésents
dans le ballet romantique, s'intéresser au
jeu scénique
: lorsqu'elle danse, le geste semble avant tout destiné à exprimer une
situation, un affect – là où la quasi-totalité des autres exécutent
avant tout une épure géométrique, beaucoup plus symbolique que
dramatique. Par ailleurs, atout tout à fait superflu en salle mais non
négligeable en vidéo, son visage aussi est très mobile, ce qui concourt
à cette impression d'évidence expressive. Elle n'est évidemment pas la
seule, mais je perçois de ce point de vue un seuil qualitatif très
impressionnant, même par rapport aux autres danseurs qui m'intéressent.
Pourtant, je ne croyais pas la voir un jour en salle (se produisant
essentiellement en Angleterre, et passée du côté de la direction
artistique…), mais la voilà, à 41 ans (âge rare dans le milieu pour des
premiers rôles dans de grandes compagnies sur de grandes scènes, sauf
erreur),
comme un oiseau blessée, mais distillant les
mêmes vérités qu'à l'ordinaire. Les costumes de la version Holmes sont
très peu clairs, et le synopsis diffère du ballet original de Mazilier,
et pourtant, à chaque fois qu'elle a paru dans une situation équivoque
(premiers pas à l'acte I, costume identique aux autres dans le rêve
d'opium du Pacha au III), j'ai immédiatement reconnu qu'un charisme
hors du commun s'exprimait et que, soudainement, la danse
m'intéressait.
Par ailleurs, ce que j'avais
peut-être moins senti jusqu'ici, sa danse
ruisselait d'enthousiasme, du plaisir d'être sur scène – alors qu'on
voyait bien, à l'amplitude légèrement réduite de certains gestes,
qu'elle devait un peu souffrir. [Fait amusant : elle était, encore plus
que ses partenaires, souvent en décalage avec le temps exact musical,
et malgré cela, paraissait davantage reliée à l'œuvre que les autres…]
Très belle expérience, l'une de
celles qui figuraient sur ma liste de spectateur avant d'aller
roupiller dans du marbre.
Par ailleurs, entourage remarquable : énormément aimé la forme de
souplesse particulière de
Ken
Saruhashi
en marchand d'esclaves (chaque geste comme arrondi, chaque épisode
comme lié, au lieu d'une suite un peu carrée de mouvements codifiés),
et convaincu comme tout le monde par
Cesar
Corrales
dans l'athlétique rôle de l'ami fidèle Ali. Une de ces parties
héroïques, les plus immédiatement visibles en termes de virtuosité et
des plus facilement accessibles pour les néophytes. J'étais dubitatifen
voyant qu'il rafflait de très loin la mise des applaudissements (pour
ce type de spectacle avec un titre et une maison relativement moins
célèbres, on ne trouve pas de gros contingents de profanes), mais les
balletomanes initiés m'ont confirmé qu'il était particulièrement
exceptionnel. Pour ma part, même si, en bon naïf, j'aime toujours les
grosses cabrioles viriles des messieurs, je lui ai surtout trouvé une
identité visuelle immédiate (tenant aussi à la chorégraphie, qui
l'individualise avec des positions et des pas spécifiques, toujours
dirigé vers le mouvement, comme une flèche), qui procurait de la
consistance, presque une psychologie, à un personnage d'adjuvant
autrement assez vide de sens.
Pour être tout à fait crédible, je suppose qu'il faut dire du mal de
quelqu'un (excuses à
Isaac Hernández)
: notre rôle-titre, déjà de « format lyrique », paraissait peu préparé
à jouer les rôles héroïques, et encore moins les mauvais garçon ; par
ailleurs, je l'ai trouvé d'une froideur extrême, exécutant une suite de
contraintes sans chercher à
exprimer
– mais j'aurais mauvaise grâce à distribuer les mauvais points dans un
art que je ne comprends pas ! Globalement, donc, beaucoup de
danseurs (de comédiens ?) de grande qualité dans une seule soirée, tout
ne peut pas toucher tout le monde (là aussi, on m'a confirmé qu'il
était très bon).
Ce sera tout pour les gambaderies, enfonçons-nous à présent dans les
choses sérieuses.
 Cesar Corrales en Ali, objet de toutes les extases balletomanes
à ce que j'ai pu lire un peu partout. Dans sa posture inclinée
spécifique
Cesar Corrales en Ali, objet de toutes les extases balletomanes
à ce que j'ai pu lire un peu partout. Dans sa posture inclinée
spécifique.
2.
Au pays de la bidouille : le rapport à l'original dans le ballet
2.1.
Scénographie
Les
costumes de Bob Ringwood sont assez étranges, à
plus d'un titre.
Ils
individualisent assez mal les
personnages.
L'esclave-vedette Gulnara ne se distingue quasiment que par un chignon,
avant de changer de tenue à de multiples reprises – c'est heureusement
à peu près le seul physique d'Extrême-Orient plateau, ce qui nous
sauve. Les pirates (oui, chez Mazilier, le Corsaire, c'est le chef des
pirates) sont habillés de façon assez aléatoire comme les gens du
peuple ; on les reconnaît uniquement à ce qu'ils dansent des solos…
Par-dessus tout, Conrad (le Corsaire), dans son élégant (et pas très
mâle) habit turquoise simili-Renaissance, ressemble davantage à
Charmant qu'à un bandit, même adouci par l'amour. Les autres
productions du Corsaire adaptées de Petipa (on trouve des bandes
récentes du Bolchoï et du Capitole de Toulouse, notamment) le vêtent de
façon beaucoup moins équivoque, du
gentleman des mers au pirate à bandeau.
Par ailleurs, même si la tradition remonte en amont de la chorégraphie
de Holmes, je me demande quand sont apparus ces
bikinis omniprésents
sur scène… je doute fort qu'il ait été licite, en 1856, d'exhiber aussi
ouvertement tout le ventre des danseuses (et davantage pour les plus
charnues) – là, il y a plutôt un petit côté Leïa-à-tutu, si je puis me
permettre. Pour moi, ce serait forcément une licence du XXe siècle,
mais le ballet servant ouvertement, au siècle précédent, aux vieux
messieurs opulents qui souhaitent entretenir de près la jeunesse (ainsi
qu'en attestent tout à la fois le cahier des charges musical et
l'architecture des théâtres, à commencer par Garnier), je fais
peut-être erreur.
Toute remarque érudite, toute piste de lecture appréciées (ici comme
pour le reste de la notule).
Les
décors sont aussi dûs à
Bob Ringwood ; comme il se doit, ils
se distinguent par un sens du kitsch assez évolué, dignes du meilleur
Ketèlbey, en particulier à l'acte II, qui cumule
la grotte, le trésor rutilant, l'ouverture sur la mer déserte et le
clair de lune parfait (sans parler des danses de pirates qui s'y
tiennent) ! Mais dans le contexte de cette musique naïve et de ce
type de ballet traditionnel, c'est aussi ce qu'on attend, et assez
jouissif en fin de compte, y compris en le percevant au second degré,
au filtre de tous les films de flibusterie diffusés depuis la mort
d'Adam et Petipa…
2.2.
Rémanence de la forme
Une des grandes vertus de cette œuvre est d'échapper à la dimension
uniquement décorative de bien d'autres ballets romantiques (supposément
des ballets-pantomimes, mais ne consistant quasiment qu'en une suite de
réjouissances sans lien avec l'action) : à défaut de psychologie
(vraiment pas le propos, clairement), il y a beaucoup d'action à
inclure, et donc
beaucoup de pas
d'action, de grands ensembles, des finals développés. On ne peut
pas se contenter de fêtes et de variations, même si on en a bon compte,
en particulier dans le rêve d'opium du Pacha (ajoutée en 1867
avec la musique de Delibes). Par ailleurs le sujet, jusque dans les
scènes de réjouissances, se prête à une veine plus exotique et plus
héroïque, un peu moins limitée de l'extatique pur.
Néanmoins, le tout reste uniquement conçu pour faire briller une
compagnie, et les liens de nécessité paraissent très ténus entre les
différents numéros. J'ai
l'impression,
en réalité, que le ballet (contrairement à l'opéra)
n'a jamais cherché, à partir de la
fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours,
à s'aprocher du réel. À l'Opéra, on
a représenté en abondance et avec succès des ouvrages véristes
(La Bohème de Puccini ou
Leoncavallo,
I Pagliacci,
Cavalleria Rusticana…),
naturalistes (
L'Attaque du Moulin de
Bruneau,
La Lépreuse
de Lazzari), des schizophrènes (
Wozzeck
de
Gurlitt ou Berg), des prostituées (
Lulu,
Eugène le mystérieux),
des tueurs en série (
Lulu),
des bagnards (
Z mrtvého
domu,
Lady Macbeth de Mtsensk)
et, pire que tout, des musiciens de jazz (
Johnny spielt auf).
Je me doute bien que ça a été fait, mais
dans le grand répertoire du ballet (alors qu'il y a une place
majeure pour les musiques « négatives » et les personnages dépravés de
Janáček, Berg ou Chostakovitch dans les saisons d'opéra), on trouve
surtout des
aventures très formelles,
qui introduisent des
numéros très
segmentés et codifiés. Comme de l'opéra
seria ou du
belcanto romantique.
Et
quand les ballets sont du XXe siècle,
soit on prend des
standards de la
musique de concert (le Sacre du Printemps est maintenant devenu
assez familier, et les nouvelles chorégraphies ont rarement la crudité
de Nijinski), sont on utilise des
scies
du répertoire pré-1900 (du Bach, du Chopin…) ou de la
musiquette contemporaine (Glass
semble être un gros client des compagnies de ballet – et, certes, son
caractère motorique s'y prête, malgré l'absence patente de musique).
Très peu de sujets très sombres et de
musiques denses, en réalité. Le sommet étant atteint avec ces
chorégraphes vivants qui commandent des orchestrations de pièces pour
piano de Chopin ou Tchaïkovski, par les plus mauvais orchestrateurs
vivants – franchement, faire d'Onéguine une œuvre sérieuse en
s'appuyant sur les danses de salon de Tchaïkovski transcrites pour
orchestre à cordes, comme chez
Cranko, il faut avoir la foi.
Je parle là du répertoire des grandes maisons, qui utilisent des
orchestres complets et non de la musique enregistrée (ou de petits
groupes) : j'ai bien conscience que la danse est un univers riche qui a
exploré beaucoup de formes et de sujets potentiels. Mais là où les
institutions officielles promeuvent un opéra au besoin trashisant (avec
des commandes à Neuwirth et Jelinek, quelquefois simultanément !), je
ne vois rien de tel dans le domaine du ballet, sauf à aller sur de plus
petites scènes, plus spécialisées.
Je ne vois de toute façon dans les
périodes récentes, même en élargissant le spectre, pas beaucoup de
musiques audacieuses majeures écrites dès le départ pour le ballet,
passé le début du XXe siècle. (Mais
Piège
de lumière de Damase reste un bijou qu'on ferait bien
d'enregistrer, soit dit en passant.)
Et à dates égales, les sujets et les
traitements des ballets sont assez spectaculairement
aimables par rapport aux opéras
sanglants qu'on jouait simultanément dans les mêmes maisons…
Toute contradiction bienvenue.
2.3.
Tripatouillages en série de l'argument
Verdi avait suivi d'assez près les péripéties de
Byron (ce n'est pas une rumeur, je
l'ai vérifié avec mes petits yeux plissés
et mon air
d'adolescent inspiré), mais on voit bien la difficulté d'en
rendre les
états d'âme sous
forme de ballet (qui occupent le plus clair du poème, quasiment tout le
chant I, une majorité du chant III, et une raisonnable portion du chant
II où se situe toute l'action).
Néanmoins,
les retournements du chant
II, où Conrad se révèle dessous un déguisement pieux, rapide
vainqueur et soudain vaincu, et où les vers de Byron deviennent
trépidants, véritable explosion
de
cape et d'épée, sont tout à fait délaissés par l'argument du
ballet. Quand Conrad veut enlever quelqu'un, il l'enlève. Et c'est
tout.
De la même façon, malgré la fin
très abrupte de l'orage (dont j'aime beaucoup la gratuité, soudaine
intrusion de l'aléatoire du réel dans un conte tout à fait prévisible),
Saint-Georges et
Mazilier ont prévu une fin heureuse
où Medora et Conrad se retrouvent après le naufrage – tandis que leurs
amis et sauveurs ont péri noyés, mais on s'en moque, ils n'avaient pas
de psychologie exploitable de toute façon.
Le rôle de
Gulnara est réduit
à presque rien dramatiquement : elle danse beaucoup, mais n'a plus
aucun rôle dans l'action du ballet – chez Byron (et subséquemment
Verdi), elle est le pivot essentiel de l'intrigue (elle résiste aux
pirates tout en permettant à Conrad de s'échapper), tandis que
Medora reste tranquillement mourir à
la maison.
Dans les utilités,
Ali l'ami inaltérable (enfin, il
pourrit au fond de la mer à la fin) et
Birbanto
le Judas exécrable sont bien sûr des produits de l'imaginaire (très
limité) des librettistes de ballet.
Rien que les noms en
attestent spectaculairement.
Le marché aux esclaves initial, qui fait des deux héroïnes des paquets
de chair fraîche (et permet d'exhiber celle,
peut-être moins
fraîche, des autres esclaves), est à ce titre aussi éloigné que
possible de l'atmosphère introspective et bagarreuse qui entoure
l'épopée de Byron au héros maudit.
Plus fort encore,
Anna-Marie Holmes n'est
pas fidèle au livret originel (sans doute ne reprend-elle que des
modifications antérieures, je n'ai pas comparé toutes les versions
documentées en vidéo, chaque compagnie a son propre fond de sauce) :
Medora est censée être
la pupille de
Lankendem, le marchand d'esclaves, et cédée à l'insistance du
Pacha (alors qu'ici son aimable mécène semble ravi de la faire
danser à demi-nue sur la place du marché), et être
enlevée au II par les conspirateurs,
alors que Lankendem le fait tout seul chez Holmes, à leurs nez et
barbes (lui sauvant peut-être la vie) – pourtant Conrad et ses amis
apparaissent au III dans le palais avec les costumes des conspirateurs,
censés s'être lancés à la poursuite de Medora (avec leurs vêtements,
donc).
Tout le
double jeu de Birbanto, feignant
devant Ali de protéger Conrad alors qu'il projetait de le poignarder,
et finalement mis à jour par Medora qui l'avait blessé (à rebours de sa
personnalité, étant la jeune fille comme il faut, contrairement à
Gulnara, la femme du sérail capable de repousser les étrangers et de
fomenter la révolte contre les siens), est aussi un ajout plus récent.
Les
visions d'opium du Pacha, avec les danses florales (connues sous
le nom de
Pas des Fleurs) qui
n'ont rien à voir et qui occupent une bonne partie de l'acte III,
servaient à complaire à Adèle Grantzow qui reprenait le rôle de Médora
à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1867, et ont été
conservées, avec la musique de
Delibes
écrite pour l'occasion, jusqu'aux versions les plus récentes.
L'ensemble du tableau est développé lors des reprises russes par Petipa
(sous le nom de
Jardin animé),
avec de nouvelles musiques (de moindre valeur, Delibes n'étant déjà pas
au faîte de sa gloire ici).
Cette liberté prise dans l'adaptation, et cet empilement de traditions
entrelacées, vers des œuvres très composites, est caractéristique du
ballet, et on ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la distance qu'il
y a avec le traitement religieux de la musique au concert et même à
l'opéra…
Or, au ballet, la musique, tout
le monde s'en moque, et elle est traitée de la même façon que le reste,
j'y viens.
2.4.
La musique : Adam dépecé
Par rapport à ses meilleurs opéras (
Le Farfadet !) ou ballets (
Giselle, bien sûr), la partition du
Corsaire est très
inférieure, mais comme on ne croule
pas sous les ballets du premier romantisme avec musique originale, on
est très content de l'entendre. [Adam n'est de toute façon pas un
compositeur majeur de cette génération, très loin, sans même mentionner
Meyerbeer ou Berlioz, de la maîtrise et de l'inventivité d'Hérold, ou
même des ponctuels coups de génie d'Auber.]
Pourtant, l'état de la partition fait dresser les cheveux sur la tête :
que reste-t-il de l'œuvre originale ?
Dès 1858, l'œuvre
voyage en Russie
(avec Petipa comme danseur, qui reprend ensuite le ballet comme
chorégraphe),
et s'y installe
durablement, avec de régulières reprises et nouvelles
productions, y compris au fil de l'ère soviétique. C'est par là,
semble-t-il, qu'elle revient en Europe Occidentale (sortie du
répertoire en France à l'issue des représentations de 1867), le
phénomène culminant avec la prestigieuse production en tournées
multiples de l'English National Ballet en ce moment à Paris.
Au fil de ses voyages dans divers pays,
les chorégraphes ayant pour tradition de reprendre à leur façon le
travail des autres (et en particulier de Petipa…)
, c'est-à-dire
de n'inventer quoi que ce soit ni de respecter rien, les
nouveaux pas et les nouvelles musiques s'amoncellent. La version de
Holmes est ainsi une adaptation de
la reprise de
Segueïev/
Sergeyev faite (d'après
Petipa…) pour le Kirov en 1973.
De fait,
les principales modifications
du
Corsaire proviennent des productions russes.
Sur le programme, on peut donc désormais lire :
musique d'Adolphe
Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Prince Pyotr van
Oldenburg, Ludwig Minkus, Yuly Gerber, Baron Boris Fitinhof-Schnell,
Albert Zabel et J. Zibin. Ce pourrait être drôle s'il n'y avait
à la fois le nom de Minkus, d'autres noms encore plus négligés (et pour
certains négligeables) de l'Histoire de la musique, et le signal
implicite que la
tradition de l'ajout,
poussée à un tel degré, signifie aussi
retrancher.
Pugni,
Minkus et
Drigo appartiennent à trois
générations successives de maîtres de ballet à Saint-Pétersbourg,
séparés par respectivement 25 et 19 ans. Contrairement à ce qu'on
pourrait craindre au demeurant, considérant la qualité de la partition
d'origine (si, si, la
fanfare aux
sabres, au I, est bien d'
Adam,
si j'en crois l'enregistrement de Bonynge), ce n'est pas forcément un
méfait musical.
Les ajouts russes
remplacent une partie du pittoresque par du sentiment, avec de
grands
pas de deux
qui sont parmi les moments les plus inspirés musicalement : l'un d'eux
(le premier de l'acte II, à mon avis) est dû à
Pugni (comme la
tempête finale, bien plus concise et
frappante que celle d'Adam), et l'autre (probablement le second, avec
son simili-Tchaïkovski, cordes lyriques et ses cors en syncope avec
frottements de secondes) correspondrait davantage à la
génération de Drigo, qui a aussi
marqué significativement la partition.
J'ai fouillé quelques heures dans
les ouvrages spécialisés et les articles d'érudition pour pouvoir
retirer ces quelques réponses (la meilleure source, et la moins
chronophage, émanant des
musiciens de fosse), ce qui est symtomatique et
très déconcertant, pour le mélomane.
Dans le même temps, dans l'univers de la
musique classique, et même à l'opéra
où la liberté scénique est devenue très grande, on ne tolère
pas la moindre liberté (même un
rubato excessif peut être
reproché), et si l'on peut accepter les coupures, tout ajout, même bon,
causerait un scandale considérable.
L'authenticité,
mirage mainte fois mentionné dans ces pages, est même un argument de
vente majeur pour les éditeurs, qui proposent de revenir au souhait
premier du compositeur, même inférieur, même inachevé, même désavoué
par lui-même. Un professionnel ne saurait exercer autrement qu'Urtext
sous le bras.
Aussi, constater cette
désinvolture
extrême envers la musique peut paraître un peu urticant au profane. Non
seulement parce qu'on
mélange les
époques, et pour des raisons purement balletistiques, sans
rapport avec la qualité musicale (et cela s'entend !) ; non seulement
parce qu'on
juxtapose des pièces
qui n'ont plus de rapport entre elles, n'ayant même pas été ajoutées
dans les mêmes versions du ballet aux mêmes époques et aux mêmes lieux…
mais pire que tout, il est excessivement difficile de retrouver la
paternité des morceaux. Sauf à
posséder le bon ouvrage, aucun document aisément accessible (même sur
les sites de danse en ligne, même dans les ouvrages généralistes sur la
danse) ne fournit le détail. Pour les ballets plus récents, on trouve (
Onéguine de
Cranko-Stolze ne m'avait pas posé de problème
insurmontable), et pour les grands standards, on finit par trouver
(beaucoup de strates dans la
Fille
mal gardée d'
Ashton-Lanchbery, mais il existe suffisamment de
documents pour recouper l'essentiel) ; mais quand la tradition s'en
mêle depuis trop longtemps, sauf à tomber sur la perle rare qui a déjà
fait le travail, c'est assez difficile – et manifestement personne n'en
a rien à faire. Les mélomanes méprisent la superficialité du ballet,
les balletomanes ne remarquent même pas qu'il y a de la musique. Avec
ça, allez vous informer !
J'ai vu, en faisant mes petites
recherches pour cette notule, qu'il existait des articles scientifiques
qui débattaient de l'état possible des premières versions de la
partition de
Giselle !
Alors, allez remonter le fil du temps pour des pièces moins courues (et
musicalement moins stimulantes)…
On en est en réalité
exactement à
front renversé de la logique musicale actuelle, où la
musicologie est l'horizon indépassable, et où l'on a toujours besoin
d'habiller tout de justification historique – même quand c'est pour
faire n'importe quoi. Si l'on veut faire de l'improvisation libre ou
introduction des instruments modernes ou exotiques, on ira au besoin
faire un peu de psychologie sur le caractère ouvert des musiques et des
musiciens, comme Bach qui aurait bien sûr repoussé comme pour son orgue
les limites de la guitare électrique façon Meshuggah, ce qui rend
légitime une petite basse amplifiée dans le continuo. Mais la plupart
du temps, on s'interdit plutôt qu'on ne s'autorise, avec ce
raisonnement ; pas question de changer une note.
Le ballet semble être resté sur
l'ancienne école, celle qui prévalait à l'opéra avant la (salutaire,
cela dit) révolution baroqueuse :
l'empilement
des traditions ininterrompues. Le public vient voir ce qu'il a
déjà vu, vient assister à la reproduction d'un patrimoine où se mêle,
espère-t-on, le meilleur de toutes les époques, et où chacun apporte sa
pierre individuellement, sans trop s'occuper de l'origine de l'œuvre
qu'il colporte.
J'essaie de ne pas juger (car je trouve un peu triste cette culture de
l'interdit dans la musique classique), mais il m'est quand même
difficile de ne pas trouver l'attitude du ballet vis-à-vis de la
musique irrespectueuse et assez poussiéreuse, je dois le confesser.
Pour les musiciens aussi, ça semble le cas : même avec des bijoux
absolus du patrimoine musical comme
La
Belle au bois dormant de Tchaïkovski, je n'ai jamais entendu
l'Orchestre de l'Opéra de Paris s'ennuyer aussi ostensiblement… Comme
un réflexe, ne pas s'engager trop dans un domaine où on ne leur laisse
qu'une place résiduelle.
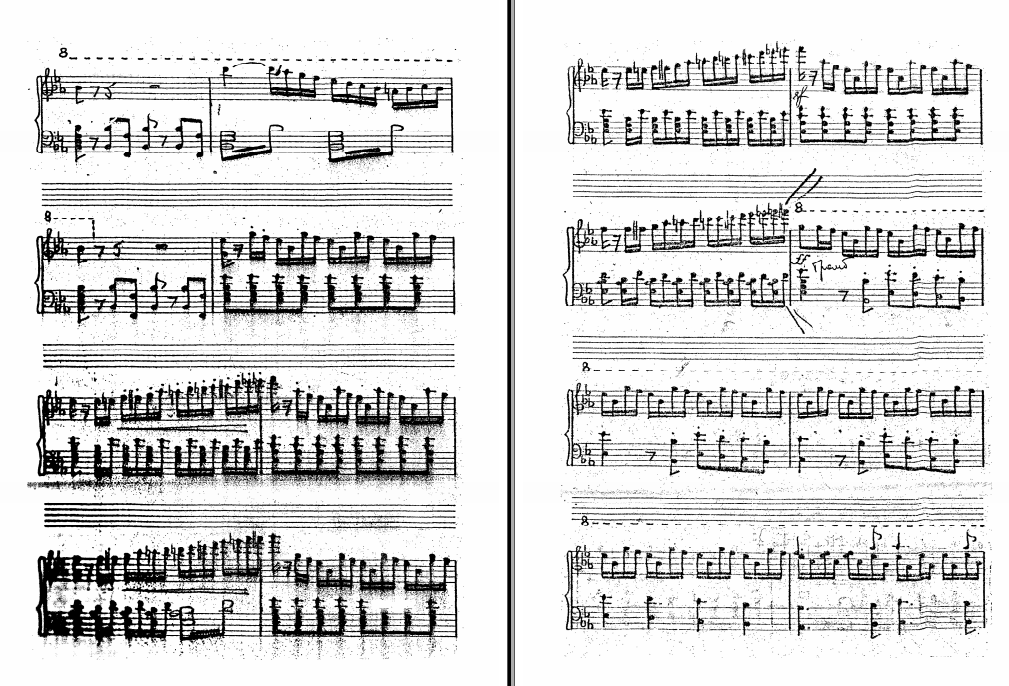 La partition en réduction piano de la tempêtes aux audaces
harmoniques (peu) fulgurantes (aplat
de I à la truelle, ça s'appelle).
La partition en réduction piano de la tempêtes aux audaces
harmoniques (peu) fulgurantes (aplat
de I à la truelle, ça s'appelle).
Manuscrit russe des années 70, lors de l'avènement de la chorégraphie
de Sergueïev, servant de base à d'autres versions ultérieures, dont
Holmes.
3.
Écouter la musique au ballet
À ce titre, l'
Orchestre Colonne
ne s'en sort pas mal : assez peu engagé à l'acte I (il est vrai
constitué d'une redoutable suite de fanfares particulièrement
indigentes), il semble qu'il s'implique davantage dans les actes II et
III, où les pas d'action sont plus nombreux et la musique moins
décorative. Le timbre général reste un peu fruste, mais point de
mollesse (même si, visuellement, on peut repérer un engagement très
inégal d'un musicien à l'autre). Comme toujours, leurs qualités
compensent nettement leur moindre maîtrise technique par rapport à la
prestigieuse concurrence parisienne.
À ce jour, à Paris, c'est l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire
(dans
Sauguet et
Damase !) qui m'a fait la meilleure impression en
fosse, aussi bien en moyens techniques qu'en investissement (sans
bondir sur leurs chaises non plus).
À Londres, l'English National Ballet est accompagné par l'English
National Ballet Philharmonic, orchestre
ad hoc qui n'a pas fait le
déplacement. J'en ai un souvenir assez positif si c'est bien lui qui
officie dans le DVD, avec un beau son et une énergie très honorable.
J'ai été surpris, lors de la représentation, par
le peu d'applaudissements du public sur la
musique : en général, on applaudit les entrées (était-ce le côté
peu clair de la première apparition de Rojo ?), et on n'attend pas la
fin de la musique. Or, excepté la fin bien sûr, tout à fait couverte
sur ses dernières secondes (je suis résigné pour le ballet, voire pour
l'opéra italien, donc ça m'indispose finalement moins que dans les
opéras germaniques ou au concert – fait partie du jeu, disons), les
spectateurs attendent la fin des numéros pour réagir. Peut-être est-ce
aussi leur écriture facétieuse (souvent un silence avant le dernier
accord) qui retient les connaisseurs. [Car je suppose que, pour une
œuvre qui n'est pas dans le top 20 des titres, pas d'un chorégraphe
célèbre, avec une compagnie qui n'a pas un nom qui claque immédiatement
pour le grand public, malgré son prestige chez les initiés – un peu
comme si on parlait de la Staatskapelle de Dresde à l'homme de la rue…
Berlin ou Vienne, soit, mais Dresde, est-ce que ça exalterait le
candide ? –, une bonne part du remplissage tenait aux vrais amateurs de
danse, désireux de voir autre chose que le ballet local, malgré son
excellence.]
En tout cas, même si pressens
vaguement qu'il s'agissait plutôt d'une coïncidence liée à l'œuvre,
agréable surprise de ce côté, ça ne hurlait pas
TamarAAAAA dans tous coins, même
si je ne m'en serais pas vraiment offusqué.
Outre le double disque
Bonynge /
English Chamber Orchestra, qui présente le ballet d'origine et
les ajouts de Delibes pour Mlle Grantzow, vous avez peut-être plutôt
intérêt, pour une adaptation plus proche de la lettre (à défaut d'en
retranscrire l'atmosphère), à vous tourner vers l'opéra de Verdi, l'un
de ses meilleurs titres de jeunesse, d'une veine mélodique discrète,
mais davantage
sans façon que
belcantiste. On y entend, dans le trio avec chœur final, des esquisses
de
Rigoletto (le quatuor et
les finals). Je recommande en particulier la gravure exaltante faite
lors du
festival de Parme dans
l'intégrale C Major (
Montanaro,
avec Lungu, Dalla Benetta, Ribeiro, voix et postures extraordinaires).
Malgré toutes ces considérations, une très belle soirée, il y a de quoi
remplir des cars de futurs initiés, si l'on est un peu sensible à
l'expression simple et généreuse de ce type de spectacle. Mais ma
satisfaction me fournissait un sujet de notule moins stimulant que
toutes ces interrogations.
Donc beaucoup de questions comme vous le voyez, auxquelles j'ai essayé
d'apporter autant que possible mes propres réponses en fouinant un peu,
mais tout prolongement et tout éclairage (en particulier concernant
l'attribution et l'intérêt de la musique) seraient hautement appréciés.